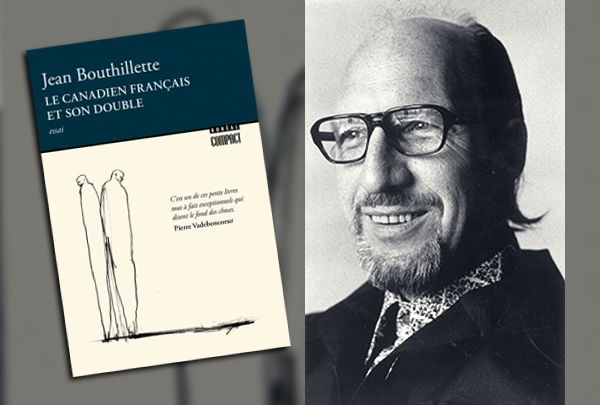
Si je vous parle de l’essai Le Canadien français et son double de Jean Bouthillette, publié originalement en 1972, dans une chronique sur les nouveautés livresques, c’est que sa réédition confirme qu’il est plus actuel que la majorité des réflexions qui se publient de nos jours.
Bouthillette y mène une réflexion philosophique, voire psychanalytique, sur « l’âme du peuple » davantage qu’une analyse proprement politique et historique. Il s’agit de l’un des rares essais politiques québécois dans lequel le style et le fond s’alimentent, où l’un n’existe pas sans l’autre. Je trahirai donc nécessairement un peu l’auteur en citant isolément des passages de cette plaquette dont l’écriture, à la fois limpide et complexe, dense et lumineuse, donne toute la profondeur au propos.
Implacablement, il analyse l’histoire de la dépersonnalisation des Canadiens français dans ce pays qu’ils croient le leur, malgré leur « histoire humiliée » qui est une « blessure toujours ouverte ». Depuis 1760, explique-t-il, « nous ne sommes plus seuls en notre pays. Non plus qu’en nous-mêmes ». Cette « subtile infiltration », cette dépossession qui se fait invisible, « nous met brutalement au monde » en nous forçant à nous définir par et contre l’Anglais. Alors que notre relation à la France était celle de la mère patrie et de sa colonie-enfant, notre identité est dorénavant en gestation « au sein d’une relation de vaincu à vainqueur ».
La Confédération masque toutefois à nos yeux notre défaite alors que, pour les Anglais, elle sanctifie la victoire britannique. Le Canada, après tout, est l’union de deux peuples fondateurs égaux, se plaît-on à nous dire le mythe tenace. Relâchant notre garde devant cette prétendue égalité, nous nous sommes lentement dépersonnalisés et le fédéralisme nous semble, de génération en génération, de moins en moins le sceau de notre domination, « le système nous apparaissant moins suspect que nous-mêmes ».
Or, la Confédération ne reconnaît pas l’existence de deux nations et deux cultures (il s’agit d’une union de provinces). Elle n’admet de nous que le français, réduisant notre originalité à la langue française, comprise comme une caractéristique individuelle. Cette nouvelle identité « canadienne » remplace tranquillement les deux premières acceptions que représentaient « Canadians » (les anglophones pour qui le Canada est le pays qu’ils ont créé et qu’ils dominent) et « Canadiens » (du nom qui était le nôtre dès la Nouvelle-France, soit un peuple francophone et catholique). Être canadien devient une « simple citoyenneté » qui nous donne les mêmes droits individuels que ceux des anglophones, mais nous nie catégoriquement en tant que peuple.
Si partout au Canada les minorités canadiennes-françaises sont en voie d’assimilation, constate alors l’essayiste, le Québec n’y échappe pas non plus : « notre langue non seulement n’est pas toujours nécessaire, mais elle est rarement suffisante ». L’individu francophone, isolé au sein d’un système économique dominé par les anglophones, doit parler anglais dans le domaine économique et le monde politique. D’outil commode de communication en Amérique du Nord, l’anglais devient non seulement nécessaire à nos yeux, mais la langue normale du pouvoir. Conséquemment, la réussite individuelle doit passer par un certain reniement de soi et de sa collectivité et, donc, par une dépolitisation.
C’est alors que l’on en vient à « un dédoublement de la personnalité collective » et que notre particularité nationale se fait invisible, en nous comme à l’extérieur de nous : « Nous ne sommes pas un peuple sans culture, mais un peuple qui a été coupé de sa culture, parce que coupé de lui-même (…) notre condition objective s’est intériorisée; elle est devenue nature, subjectivité ».
Pour favoriser notre survie, le nationalisme traditionnel se console dans un passé idéalisé. Notre caractère francophone « s’insinue en nous comme une réminiscence », vestige d’une époque d’avant le malheur de la Conquête « qui s’est figé dans l’âme commune en une durée qui nous ravit le présent ». C’est pourquoi nous glorifions et détestons à la fois la France qui nous a faits orphelins, y cherchant notre image originelle que le temps a en nous déformée.
Ce nationalisme traditionnel, qui a été irrationnel dans son « refus de l’Anglais et son refuge dans le passé », a parfaitement incarné notre dépossession. « Plus qu’un simple conservatisme, il est essentiellement un arrêt du temps et des choses ». C’est hors de l’Histoire qu’il nous a installés et nous maintient encore aujourd’hui.
Nous voyant ressembler à l’Autre, nous avons voulu le rejeter, mais ce refus de l’Anglais, poursuit Bouthillette, se double paradoxalement d’un « secret consentement à l’Anglais ». Ainsi, notre élite a joué un double jeu politique pourtant antagoniste : faire croire aux francophones en leur capacité à défendre la nation et assurer les anglophones de leur collaboration. Délaissant la conscience des causes réelles de notre aliénation que sont la Conquête et la Confédération, « notre dépossession devient imaginaire et nos maux, le fruit de notre propre incurie ».
Notre « haine originelle » de l’Anglais a fini par se muter en culpabilité nationale – doublée d’une culpabilité religieuse – qui retourne contre nous-mêmes notre haine de l’Anglais. Ce « second mal » - « le huis clos de notre condition » - s’est longtemps cristallisé dans la religion : le danger de « l’Anglais conquérant » a été remplacé par le danger de « l’Anglais protestant ». Rien de notre dépossession politique et économique ne devait transparaître.
Ce refus/consentement à l’Anglais s’est cadenassé au cœur de notre aliénation dans un « refus non moins inconscient de nous-mêmes ». En même temps que nous avons créé notre nationalisme traditionnel, nous nous sommes vautrés dans un « universalisme abstrait » lorsque nous avons épousé le « pancanadianisme dépersonnalisé, qui, sous des extérieurs d’une ouverture à l’Autre et au monde, est secrètement une fermeture à soi ».
Le nationalisme clérical a donné des armes au pancanadianisme : résister au cléricalisme équivalait nécessairement à lutter contre la nation canadienne-française. Le nationalisme des autres était acceptable; le nôtre dangereux, suspect et rétrograde.
Bien qu’opposées, les deux idéologies représentent « les deux voix antagonistes d’une même conscience déchirée, les deux regards faussés d’une même schizophrénie », qui nous neutralisent et nous empêchent de choisir. Ainsi, ce « dédoublement de la personnalité a fait de nous deux parts étrangères l’une à l’autre et que la culpabilité a promises à l’inimitié. Dans la nuit de cette servitude intérieure totale, nous sommes devenus un peuple terrible d’inexistence – de l’inexistence du colonisé ».
Les deux visages de notre tête traditionaliste-universaliste n’ont aucune prise sur notre absence de liberté collective. Les nationalistes conservateurs nous enjoignent à plus de fidélité envers la tradition alors que les pancanadianistes appellent à plus de vertus démocratiques et « voudraient que nous fussions des saints sur l’autel d’une liberté qui nous trompe » en nous niant collectivement.
Malgré les torts du nationalisme traditionnel dont il faut irrémédiablement s’éloigner, argumente cependant Bouthillette, notre lutte pour la survie du Québec, « au-delà des apparences, a toujours été une lutte pour la liberté ». Conséquemment, il faut encore plus fortement refuser le pancanadianisme et reconquérir notre indépendance afin d’ouvrir un nouveau « dialogue de la liberté et de la vie ».
Or, Bouthillette conclut gravement. L’ennemi est principalement en nous, fruit de notre dépossession : « ce que doit d’abord vaincre notre peuple, c’est sa grande fatigue, cette sournoise tentation de la mort ».
Même si Bouthillette n’est mort qu’en 2015, Le Canadien français et son double est demeuré son seul essai. Après deux échecs référendaires et devant notre américanisation galopante, autre visage de notre dépossession, pourquoi n’a-t-il pas poursuivi sa réflexion?
La dernière section de l’essai intitulée « Reconquête » ne fait que trois pages. Comme si le diagnostic une fois établi, l’auteur n’avait pas su quel remède proposer. Est-ce un aveu indirect d’échec devant la difficulté de se libérer de notre double ?
Le Québécois a-t-il transcendé cette réflexion écrite dans les années 1960? Je crois que chaque aspect de l’analyse nous habite encore et que nous pourrions aujourd’hui intituler l’essai Le Québécois et son double. Néanmoins, prendre conscience de notre condition est, dit-on, le premier pas vers son dépassement.
Jean Bouthillette, Le Canadien français et son double, Montréal, Boréal compact, 2018.
Du même auteur
| 2016/03/01 | Pierre Perrault et la reconquête du territoire de l’âme |
| 2016/01/27 | Un Canadien français parmi nous |
| 2015/11/16 | Rien n’a de valeur que le divertissement qui emporte tout sur son passage |
| 2015/10/27 | Aussi transparents que notre blanche démocratie |
| 2015/09/30 | Les natifs de l’abandon |
Pages
Dans la même catégorie
| 2022/05/17 | Bono à Kiev |
| 2022/05/13 | Le Patriarcat en plein cœur |
| 2022/05/11 | La dislocation de la famille québécoise |
| 2022/05/06 | La nation qui n’allait pas de soi |
| 2022/04/14 | Miguel Angel Estrella, artiste pour la paix |
































