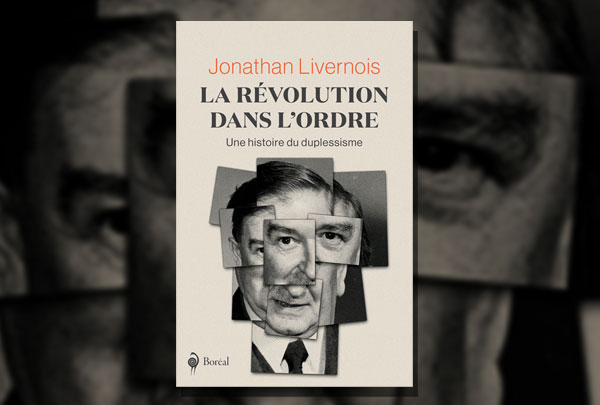
Lorsque l’on s’intéresse à l’histoire québécoise, on ne peut que s’étonner de la discordance aiguë entre la mémoire collective et l’histoire universitaire. Si ce phénomène n’est pas unique au Québec, car il s’agit partout d’une lutte ininterrompue entre la perception citoyenne quelque peu stagnante et le travail de réinterprétation incessant des universitaires, il y est plus prononcé qu’ailleurs.
Au cœur de cette dynamique se trouve le couple « Grande Noirceur-Révolution tranquille », délimitation que les universitaires nuancent depuis déjà une quarantaine d’années. Or, les études sur les années 1960 et 1970 sont beaucoup plus nombreuses que celles sur les années d’après-guerre. Ceci n’est pas sans poser problème : comment peut-on mesurer la portée de la « révolution » si l'on connaît assez mal ce qui la précède ?
Dans son essai La révolution dans l’ordre. Une histoire du duplessisme (Boréal), Jonathan Livernois dresse à la fois un portrait de la « fortune mémorielle » et de l’historiographie sur le sujet. L’essayiste prend somme toute assez peu position sur le débat, répétant que « la vie politique du régime Duplessis n’est jamais limpide » puisqu’une partie des archives de Duplessis et de l’Union nationale a été perdue.
Livernois décrit d’abord les actions concrètes de Duplessis; « le prince de l’amabilité » des années 1920, que la crise des années 1930 rendra moins princier et plus populiste; son premier gouvernement, de 1936-39, généralement ignoré; l’évolution du long mandat de 1944 à 1959. Si Duplessis est en partie en phase avec la société canadienne-française à la fin de la guerre, il en va autrement au tournant des années 1960.
L’auteur nous dit à juste titre qu’il faut cesser de ne voir que de la mauvaise foi en Duplessis : Il était un croyant et un nationaliste sincère, ce qui n’exclut pas le calcul politique, bien sûr. S’il n’était pas un dictateur, Duplessis était certainement un homme autoritaire, peu soucieux de la démocratie, qui décidait de l’essentiel de la politique unioniste, présentait lui-même les projets de loi. Plusieurs intellectuels ont évidemment lutté contre Duplessis et, s’il est vrai qu’il était réellement dangereux de prendre position publiquement contre la tradition et l’UN, il ne faut pas en exagérer la portée.
Même si Duplessis était plus interventionniste qu’il ne l’admettait (et qu’on le retient), ne pas instituer l’État-providence lui permettait de sauvegarder le pouvoir de l’Église et de poursuivre le patronage et la corruption. Mais, en cela comme en plusieurs autres points, Duplessis prolonge – et « améliore » – les tristes tactiques politiques et les idéologies des libéraux d’avant lui, rappelle l’essayiste.
Livernois explique ensuite le débat historiographique divisé entre une conception moderniste qui reproche le passéisme de Duplessis et une représentation structuraliste qui insiste au contraire sur le caractère bourgeois et libéral de son gouvernement. L’essayiste a raison d’affirmer que cette dernière est réductrice puisqu’elle ne prend que peu en compte les idéologies et la culture politique de l’époque.
On s’étonne cependant que Livernois n’aborde pas de front la vision néoconservatrice des Mathieu Bock-Côté et Éric Bédard, de plus en plus présente dans les médias et les livres d’histoire, ce qu’il avait pourtant commencé à esquisser dans Remettre à demain (Boréal). L’idée apparaît d’autant plus pertinente que Livernois cite des brochures et des discours unionistes qui font nommément référence à la « survivance », thème cher à Bédard.
Il ne faut pas non plus omettre que c’est l’ensemble de l’Occident, après 30 années catastrophiques favorisant les remises en question de l’ordre, qui cherche la stabilité dans les valeurs traditionnelles. Les années 1960 apparaissent partout comme un déliement de plusieurs nœuds. Ce sentiment de rupture et d’accélération du temps – qu’il soit plus ou moins réel n’y change rien – n’est pas l’apanage du Québec.
Cette question m’apparaît d’autant plus cruciale que Livernois affirme que les succès de Duplessis peuvent s’expliquer par un rapport complexe au temps, celui de la « révolution dans l’ordre » : « Duplessis et son régime ont surimposé, argumente-t-il, un temps réconfortant parce que cyclique, répétitif et, en fin de compte, permanent (…) la tradition n’est pas seulement convoquée afin d’asseoir la stabilité du régime bourgeois et libéral, mais également pour réconforter les Canadiens français eux-mêmes, individuellement et collectivement ».
L’essayiste renoue ici avec l’idée maîtresse de Remettre à demain : l’histoire du Québec s’explique par la « permanence tranquille », soit « l’illusion que les choses reviennent toujours, qu’ils peuvent ainsi différer les prises de décisions importantes ». Cela a permis, poursuit-il, que « le Québec ne change pas … tout en changeant (…) sans heurts, sans violence, sans … changement », ce qui accouchera d’un « temps idéologiquement saturé » à l’époque duplessiste. De la « révolution dans l’ordre » à la Révolution tranquille, il n’y a qu’un pas, nous dit Livernois.
Cette thèse, présentée au milieu de l’essai, disparaît un long moment pour ne revenir vraiment qu’à la conclusion, comme si l’auteur ne parvenait pas à la confronter aux explications des historiens et aux décisions concrètes duplessistes. Cela ne signifie pas qu’elle soit fausse, mais l’argumentation semble mince.
Quoi qu’il en soit, la question de notre rapport malaisé à ces quinze années demeure. Livernois, qui qualifie pourtant « d’esprits chagrins » ceux qui colportent l’idée de Grande Noirceur, affirme à juste titre : « Quand bien même tous ces gens [qui ont lutté contre Duplessis] se seraient illusionnés sur la teneur du régime, sur le climat ambiant, ils n’en ont pas moins souffert ». Il évoque ici la difficile réconciliation des perceptions et des faits empiriques.
Si, n’ayant pas vécu la Révolution tranquille, je suis d’avis que les années duplessistes ont été une « petite pénombre », comme le disait Jacques Ferron, je crois qu’il ne faut pas mépriser la thèse de la Grande Noirceur dictée par la mémoire collective, comme le font trop souvent les universitaires. Il me semble au contraire impératif de comprendre cette perception qui en dit long sur notre blocage collectif et de l’interpréter à la lumière de notre situation particulière en Amérique du Nord.
L’historien devrait pratiquer l’humilité de celui qui n’a pas été contemporain des événements qu’il étudie. Comment peut-on mesurer « l’ambiance » et les non-dits d’une époque? Comment le discours ambiant des élites conservatrices pouvait-il être à ce point étouffant pour des gens dont les idées étaient déjà ailleurs ? Comment, en somme, interpréter cette discordance de deux temps historiques ?
Tant qu’une histoire du duplessisme intégrant cette perception qui perdure ne sera pas écrite, il sera impensable d’affronter la ligne de rupture que notre mémoire collective détermine comme absolu et dont les historiens ne savent que faire.
Cela dit, Livernois ne prend pas position sur la particularité du duplessisme et conclut, un peu paradoxalement : « [Duplessis] est, comme plusieurs autres figures du Québec ancien, mal mort. Le temps duplessiste, non plus, n’est pas tout à fait mort : n’espérons-nous pas encore une révolution dans l’ordre, celle qui prend les décisions à notre place, à notre insu, sans fracas? » Il n’a pas tort, mais si cette permanence tranquille est encore la nôtre, on voit mal ce que la « révolution dans l’ordre » a de distinct dans notre histoire, d’autant plus que cette permanence a débuté, nous disait-il dans Remettre à demain, dès les lendemains patriotes, si ce n’est avant.
Citant Pierre Maheu de Parti pris, Livernois ajoute qu’il faut développer « une démarche paradoxale qui consiste à assumer un certain passé national, mais à l’assumer comme passé, justement, c’est-à-dire à le poser du même coup comme dépassé ». Cette tâche est en effet capitale.
Du même auteur
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
| 2024/01/26 | De quel Godin te souviens-tu? |
| 2023/12/15 | La colère d’Octobre |
| 2023/12/13 | L’inflexibilité d’une CAQ à contre-courant |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/04/10 | Propulser les voix théâtrales |
| 2024/04/03 | L’idéaliste et le tueur dans « La fonte des glaces » |
| 2024/02/16 | Une entrevue avec M. Bernard L'Heureux |
| 2024/02/14 | Cheminer entre création et cycles de la vie |
| 2024/01/26 | Des photos de M. Jacques Nadeau |































