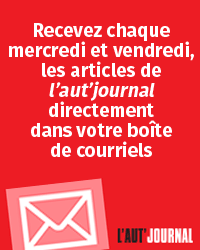La stratégie du gouvernement fédéral pour contrer le mouvement souverainiste se déployait sur plusieurs axes. D’une part, il fallait « gagner du temps » et édulcorer le projet péquiste. Ce à quoi s’employa Claude Morin. D’autre part, il fallait détacher certaines forces sociales de l’influence péquiste pour les amener dans l’orbite fédérale ou, tout au moins, les neutraliser. Dans le collimateur du fédéral, figuraient bien entendu les milieux d’affaires québécois.
Au cours de la période comprise entre l’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976 et le référendum de 1980, allaient se conclure une série de transactions financières au bénéfice de l’élite économique du Québec de façon à ce qu’elle se prononce contre le projet péquiste ou se contente de la recherche d’un statut particulier comme Claude Morin et René Lévesque aillaient bientôt le proposer. Au cœur de ces transactions financières, nous retrouvons un autre personnage clé de l’époque, le financier Paul Desmarais, dont le rôle est plus complexe qu’il n’y paraît à première vue.
Les interventions politiques musclées de Paul Desmarais remontent au milieu des années 1960. En 1966, Daniel Johnson fait campagne sur le thème « Égalité ou indépendance », titre d’un livre qu’il venait de publier et dans lequel il réclamait pour le Québec 100% des impôts sur les profits des sociétés, 100% des impôts des particuliers et 100% des impôts sur les successions. De telles revendications équivalent, à toutes fins pratiques, à une déclaration d’indépendance. Johnson est élu grâce à la division du vote libéral par le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) qui récolte 6% des suffrages. Johnson avait conclu une entente secrète avec Pierre Bourgault en vertu de laquelle les deux concentreraient leurs critiques sur le Parti libéral de Jean Lesage et éviteraient de s’en prendre l’un à l’autre.
L’année suivante, le « Vive le Québec libre » du Général de Gaulle dramatise la situation et jette la panique dans les rangs fédéralistes. Daniel Johnson est invité à aller encore plus loin par de Gaulle qui, dans une lettre manuscrite que ce dernier lui a fait porter, écrit : « On ne peut plus guère douter que l’évolution va conduire à un Québec disposant de lui-même à tous égards. C’est donc – ne le pensez-vous pas? – le moment d’accentuer ce qui est déjà entrepris. Il faut des solutions », dit encore le général, offrant le soutien de la France à cette « grande opération nationale de l’avènement du Québec ».
Tout cela en était trop pour Ottawa et les fédéralistes. Dans sa biographie de Daniel Johnson, le journaliste Pierre Godin raconte comment la contre-attaque s’est orchestrée. Pendant que Daniel Johnson prenait à la fin du mois de septembre 1967 des vacances à Hawaï, les journaux de Power Corporation commencent à faire état d’une désastreuse fuite de capitaux. Charles Neapole, le président de la Bourse de Montréal, confirme l’information mais sans donner de chiffres. Des dirigeants de la Banque de Montréal, de la Banque Royale et du Trust de Montréal harcèlent chaque jour le ministre des Finances Paul Dozois de leurs appels alarmistes. « Money is leaving the province », clament-ils. C’était évidemment faux, comme l’a révélé plus tard Jacques Parizeau en vérifiant les transactions financières au cours de cette période.
Au même moment, Paul Desmarais et Marcel Faribault du Trust Général et membre du conseil d’administration de Power Corporation, accompagnés d’un journaliste de La Presse, prennent l’avion pour Hawaï afin de « mettre Johnson au courant de la fuite de capitaux ». Profitant du climat de panique qu’ils viennent artificiellement de créer, ils convainquent Daniel Johnson d’effectuer un « recul stratégique » pour rassurer les milieux financiers. Ils lui font signer une déclaration qui sera reproduite le lendemain en première page de La Presse sous le titre : « Pas de muraille de Chine autour du Québec ». Immédiatement, le premier ministre canadien Lester B. Pearson se réjouit de la déclaration et Pierre Elliott Trudeau, alors ministre de la Justice, déclare que « le document d’Hawaï rejoint la politique d’Ottawa ».
À Hawaï, Paul Desmarais obtient la nomination de Marcel Faribault au poste de « conseiller spécial » du premier ministre Johnson en matière constitutionnelle et économique et celle de Charles Neapole à la Caisse de dépôt.
À la conférence constitutionnelle qui suit, Daniel Johnson ne fait mention ni d’indépendance, ni d’égalité, ni de rapatrier 100% des impôts. Il parle plutôt de fédéralisme renouvelé et de nouvelle constitution au grand étonnement des autres premiers ministres et de la presse. À la grande déception du Général de Gaulle, Daniel Johnson ne reparla plus jamais d’indépendance et on raconte que Paul Desmarais a conservé jalousement comme trophée de chasse l’original de la déclaration de Hawaï.
Le sort de Daniel Johnson étant réglé, les gens de Power Corporation pouvaient maintenant s’occuper de celui de René Lévesque qui voulait pousser le Parti libéral, dont il était ministre, à endosser ses thèses sur la souveraineté-association. L’attaque fut menée au congrès du Parti libéral par le ministre Éric Kierans et le premier ministre Jean Lesage. René Lévesque se retira du congrès avant d’être exclus du Parti libéral et il mettra sur pied quelques mois plus tard le Mouvement souveraineté-association (MSA). Après son retrait de la vie politique, Jean Lesage fut invité à siéger sur le conseil d’administration de Power Corporation.
Au même moment, Desmarais organise la course de Trudeau à la chefferie du Parti libéral et son élection à la tête du pays le 25 juin 1968, le lendemain de l’émeute de la Saint-Jean-Baptiste. Avec Trudeau aux commandes, l’objectif est de réprimer l’agitation politique et sociale au Québec, mais également de mettre fin au mouvement de décentralisation de la fédération canadienne que le pays avait connu sous l’administration de Lester B. Pearson. Les milieux d’affaires du Canada anglais en avaient tiré la conclusion suivante : la politique des concessions au Québec pratiquée par le gouvernement Pearson, plutôt que de freiner le développement du mouvement de revendications au Québec, a attisé ses appétits. Il était temps de renverser la vapeur et de passer, avec un gouvernement Trudeau, à la répression – les mesures de guerre en Octobre 1970 – et à une politique centralisatrice.
Si Paul Desmarais sait manier le bâton, il peut aussi offrir la carotte. Entre l’élection du Parti québécois en 1976 et le référendum de 1980, il agit comme plaque tournante d’une série de transactions financières qui vont lier les intérêts des milieux d’affaires nationalistes québécois au destin du Canada anglais.
Un peu d’histoire est nécessaire pour comprendre les dessous de ce qui va se passer entre 1976 et 1980. Vers la fin des années 1950, une alliance s’est forgée au sein du Parti libéral entre des hommes d’affaires québécois et la Banque Royale pour déloger du pouvoir la vieille coalition de la Banque de Montréal et de l’Église catholique qui dominent alors la société québécoise par l’intermédiaire de l’Union nationale de Maurice Duplessis. En fait, cette alliance a pris forme à la Deuxième Guerre mondiale avec les liens qui se sont tissés entre la Banque Royale et la famille Simard de Sorel qui s’était vu octroyer de généreux contrats fédéraux pour ses chantiers maritimes.
Au cours des années 1960, la coalition s’élargit pour inclure d’autres sections de la classe d’affaires québécoise. C’est alors que la Banque Royale s’entend avec la Banque Canadienne Nationale pour créer en 1963 RoyNat, une société spécialisée dans les prêts aux entreprises.
La nationalisation de l’électricité en 1962 est un excellent théâtre pour voir à l’œuvre les groupes d’intérêt qui vont continueront à s’affronter par la suite. Les dirigeants de Power Corporation, groupe lié à la Banque Royale et qui détenait la majeure partie des installations visées, n’étaient pas opposés au principe de la nationalisation. Le taux de profit du secteur de l’électricité était tombé entre 2% et 6% et le gouvernement offrait de payer 20% de plus que la valeur réelle des actions. L’entente fut conclue et l’argent encaissé a servi à édifier l’empire que l’on connaît.
L’opposition venait des cadres anglophones des compagnies visées - qui savaient que la nationalisation signifiait leur remplacement par des francophones - et du syndicat financier A.E. Ames et Co. Ltd, lié à la Banque de Montréal. Cette opposition s’exprima au sein du Cabinet Lesage par l’intermédiaire du George Marler, membre du Conseil législatif (le défunt sénat provincial composé de non-élus), qui représentait officieusement à Québec les intérêts de la rue Saint-Jacques.
Le syndicat financier contrôlait les emprunts du gouvernement du Québec depuis la chute du gouvernement d’Honoré Mercier à la fin du siècle dernier. Mercier, qui avait pris le pouvoir dans la foulée de l’immense réaction nationaliste qu’avait suscitée au Québec la pendaison de Louis Riel, avait tenté de détacher le Québec du giron des milieux financiers canadiens en empruntant auprès de financiers français, belges et états-uniens. La Banque de Montréal et ses acolytes provoquèrent la chute de Mercier, à la faveur d’un scandale, et reprirent le contrôle des finances de la province.
En 1962, lorsque le syndicat financier A.E. Ames et Co. Ltd voit qu’une maison de courtage états-unienne s’offre pour rassembler les capitaux nécessaires à la nationalisation de l’électricité, il comprend ce qui se trame. Plutôt que de tout perdre, il change son fusil d’épaule, met fin à son opposition et s’associe à la First Boston Bank pour fournir les capitaux. Une alliance entre des intérêts québécois, la Banque Royale et des banquiers de la côte est des États-Unis avait réussi à contrer l’opposition des intérêts traditionnels de la rue Saint-Jacques.
La nationalisation de l’électricité met fin au pouvoir d’entreprises anglo-saxonnes qui s’étaient partagé le territoire du Québec en autant de petits fiefs et qui freinaient son développement économique. Au nombre de ceux qui avaient réclamé à hauts cris la nationalisation, on retrouve, bien entendu, des entreprises québécoises en pleine croissance dans le contexte des années de prospérité de l’après-guerre. Au premier plan d’entre elles, il y a le Mouvement Desjardins. En 1960, le mouvement des Caisses populaires dépasse en importance les deux banques canadiennes-françaises : la Banque Canadienne Nationale et la Banque Provinciale. Alliés dans le cadre de la nationalisation de l’électricité, les intérêts de Desjardins et du groupe dirigé par la Banque Royale vont rapidement s’entrechoquer. La crise au sein du Parti libéral entre les fédéralistes et les nationalistes, personnifié par l’affrontement entre Jean Lesage et René Lévesque, en est l’expression politique.
Avec la fondation du Parti québécois, après l’exclusion de Lévesque du Parti libéral, le Mouvement Desjardins a désormais son propre véhicule politique. Il faut lire Option-Québec, le document fondateur du Parti québécois, le manifeste « Quand nous serons vraiment maîtres chez nous » et les différents programmes du parti, pour constater jusqu’à quel point les intérêts du Mouvement Desjardins y sont bien représentés.
Déjà à cette époque, le Mouvement Desjardins, protégé de toute prise de contrôle hostile par son statut de coopérative, fonctionne comme une banque. Il contrôle 25% du capital-actions de la Banque Provinciale et une série d’autres institutions financières comme la Sauvegarde, l’Assurance-Vie Desjardins, la Sécurité, la Société d’Assurance des Caisses populaires, la Fiducie du Québec. Il est aussi impliqué dans le secteur industriel par le biais de la Société d’Investissement Desjardins et le Crédit industriel Desjardins. Par l’intermédiaire de ces institutions, il contrôle ou possède d’importants intérêts dans Culinar, Canam-Manac, Sico, Treco et une série de petites et moyennes entreprises. En assurant le financement des PME, Desjardins les regroupe, les concentrent. Culinar, par exemple, contrôle la pâtisserie Vachon, les produits Diamant, les biscuits David, etc.
En 1976, la victoire du Parti québécois est aussi la victoire du Mouvement Desjardins. Rapidement, le nouveau gouvernement amende la charte de la Caisse de dépôt de façon à rendre obligatoire la représentation au conseil d’administration d’un dirigeant du mouvement coopératif. Des membres de Desjardins sont aussi nommés sur les conseils d’administration de plusieurs sociétés d’État avec les bénéfices qu’on imagine. Par exemple, la Société québécoise d’Initiative agro-alimentaire (SOQUIA) fait d’importants investissements dans Culinar.
Manifestement, le rapport de forces se transforme dans le milieu des affaires avec les politiques linguistiques et économiques du Parti québécois. C’est alors qu’entre en jeu Paul Desmarais. Peu après les élections de 1976, il invite Michel Bélanger, le p.d.-g. de la Banque Provinciale et Rolland Giroux, un ancien dirigeant d’Hydro-Québec et un des principaux artisans de la nationalisation, à venir siéger sur le conseil d’administration de Power Corporation où se trouve déjà Daniel Johnson Jr, le fils de l’ancien premier ministre, et dont le frère Pierre-Marc fait partie du Cabinet péquiste.
Puis, Desmarais tisse une nouvelle toile économique où vont s’entremêler ses intérêts et ceux des groupes financiers québécois. Power Corporation cède la Laurentide Finance à la Banque Provinciale, ce qui permet à cette dernièere d’envisager de pouvoir étendre son réseau de succursales à travers le Canada. Desmarais cède à la Laurentienne la compagnie d’assurances Imperial Life installée au Canada anglais. Mais la pièce de résistance est la fusion de la Banque Canadienne Nationale et de la Banque Provinciale pour créer la Banque Nationale où les intérêts de Power Corporation et du Mouvement Desjardins se trouvent désormais entrelacés. En effet, Power Corporation et le Mouvement Desjardins sont les deux principaux actionnaires de la nouvelle institution avec respectivement 7% et 11% des actions.
La genèse de cette dernière transaction est fort instructive. En 1977, les Caisses populaires mettent la main sur 12% du capital-action de la Banque d’Épargne. La rue Saint-Jacques flaire rapidement la possibilité d’une fusion entre la Banque d’Épargne et la Banque Provinciale qui est contrôlée à 25% par Desjardins. La fusion créerait une nouvelle banque francophone avec un actif de 5 milliards $ qui talonnerait la Banque Canadienne Nationale. Pour confirmer les inquiétudes des financiers de la rue Saint-Jacques, le ministre des Finances Jacques Parizeau déclare au même moment : « Il ne serait pas mauvais de regrouper les avoirs fermes des Québécois ». Il n’en fallait pas plus. La contre-offensive s’organise rapidement autour de la Banque Canadienne Nationale, liée depuis 1963 à la Banque Royale. En une seule journée, des blocs entiers d’actions changent de mains provoquant la réorganisation complète de l’organigramme de la Banque d’Épargne de façon à empêcher sa prise de contrôle par le Mouvement Desjardins. Finalement, après bien des péripéties, la Banque Provinciale fusionnera avec la Banque Canadienne Nationale pour former la Banque Nationale. Quant au contrôle de la Banque d’Épargne, il passera entre les mains de la Laurentienne qui s’associera de plus en plus à Power Corporation.
D’autres institutions financières québécoises ont aussi leur part du gâteau. Le Trust General dont la Banque Nationale et la Laurentienne détiennent 28% des actions - la Banque Nationale et la Laurentienne ont sept administrateurs en commun - fait l’acquisition de Sterling Trust, une institution financière ontarienne. Le groupe Prenor, dont la Caisse de dépôt et la Banque Nationale sont les deux principaux actionnaires crée une filiale à Vancouver, Paragon Insurance Co. La Banque d’Épargne dont la Banque Nationale et la Laurentienne détiennent respectivement 18% et 20% des actions fait l’acquisition du Crédit Foncier Franco-Canadien - une entreprise contrôlée par la Banque de Paris et des Pays-Bas avec laquelle Desmarais est en relations d’affaires - ce qui lui permettra d’étendre son réseau de succursales à travers le Canada.
D’autres transactions sont dignes de mention. La Caisse de dépôt prend le contrôle de Domtar avec l’aide de Paul Desmarais. Provigo acquiert M. Loeb. Sodarcan, la compagnie d’assurances contrôlée par la famille Parizeau, achète Dale-Ross Holdings Ltd, dont la fusion avec la plus grande compagnie mondiale d’assurances et de courtage, l’américaine Mars S. McLennan, a été bloquée par le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur la tamisage des investissements étrangers.
C’est donc sans surprise qu’on a pu lire dans les journaux de l’époque cette déclaration de Marcellin Tremblay, président des Prévoyants, une filiale du groupe Prenor : « Paul Desmarais et Alfred Rouleau (le p.d.-g. du Mouvement Desjardins) se rejoignent dans ce qu’ils veulent faire du Québec ».
Désormais, les portes qui leur avaient toujours été fermées au Canada anglais semblent enfin devoir s’ouvrir comme par magie pour les principaux groupes financiers québécois. Desjardins, la Banque Nationale, la Laurentienne, la Banque d’Épargne envisagent de pouvoir se développer d’un océan à l’autre.
Cette nouvelle alliance économique et financière se devait d’avoir son expression politique. Le Parti québécois, qui avait flirté avec les États-Unis et laissé entrevoir que l’alliance projetée pourrait en être une nord-sud, change subitement d’orientation. Le gouvernement Lévesque annonce son intention de mettre un frein au développement de nouveaux barrages hydro-électriques et à la vente d’électricité aux États-Unis, au profit du gaz naturel albertain et de la vente d’électricité aux autres provinces.
À la faveur d’un remaniement ministériel, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Rodrigue Tremblay, est destitué et il quitte le Parti québécois pour siéger comme indépendant. L’économiste Rodrigue Tremblay s’était fait connaître avec la publication d’un livre prônant un marché commun Québec-États-Unis. Le nationaliste canadien Éric Kierans – le même qui avait orchestré l’expulsion de René Lévesque du Parti libéral – est nommé pour siéger au conseil d’administration de la Société générale de financement (SGF).
Pour tous ceux qui savent décoder ces décisions politiques, le message est clair : le Parti québécois délaisse l’option états-unienne pour une nouvelle alliance avec le Canada anglais, plus précisément avec l’Ontario. Le Québec offre à l’Ontario une entente « d’égal à égal » pour contrer les plans de balkanisation du Canada qui se retrouvent dans le programme du Parti conservateur et dans le Livre beige du Parti libéral de Claude Ryan.
L’offre n’est pas nouvelle. Déjà, en 1967, lors du célèbre voyage en train qui devenait l’amener à Banff et qui devait marquer sa conversion à l’option indépendantiste, Jacques Parizeau avait déclaré aux hommes d’affaires canadiens-anglais que la seule façon de freiner la balkanisation du Canada était d’accepter les revendications du Québec.
Il dénonçait le mouvement de décentralisation au Canada en faveur des provinces et le fait « de vouloir traduire dans la constitution le mouvement de décentralisation de notre politique économique et sociale que, selon moi, nous avons déjà poussé trop loin ». Pour Parizeau, la seule façon de remédier à la situation était de donner satisfaction aux revendications du Québec, car « les difficultés viennent du Québec et de nulle part ailleurs ».
Ce qui était faux, mais envoyait le signal que le Québec était prêt à s’allier à l’Ontario contre les provinces de l’Ouest. Pour bien signifier qu’il partageait cette opinion, Lévesque a reproduit à l’époque ce discours en annexe de Option-Québec. Quelques années plus tard, dans le Livre blanc sur la souveraineté-association, la même thèse est reprise avec l’affirmation que « l’accroissement des pouvoirs et de l’influence du gouvernement central répond aux aspirations de la communauté canadienne-anglaise ».
Quelle forme pourrait prendre cette alliance? Lévesque et Morin l’ont énoncé lors d’une rencontre à huis-clos avec une quarantaine de consuls généraux de divers pays peu avant la tenue du référendum. Par le plus curieux des hasards (!), le procès-verbal de cette rencontre est parvenu à La Presse et au Devoir qui en ont reproduit des extraits dans leur édition du 1er février 1980.
Selon les reportages parus dans les journaux, Lévesque aurait déclaré, en faisant référence aux propositions contenues dans le Livre blanc sur la souveraineté-association, que « la parité est absolument essentielle pour les institutions politiques », mais il s’empressait d’ajouter « au moins pour la période de démarrage ». Il ajoutait qu’il serait par la suite « possible d’apprendre avec le temps à pondérer, mais en réservant les intérêts essentiels ou les choses vraiment fondamentales des partenaires ».
Claude Morin déclara devant le corps consulaire qu’il était fort possible que le second référendum n’ait jamais lieu. Selon Morin, un deuxième référendum ne serait nécessaire que dans l’éventualité d’un succès total ou d’un insuccès total des négociations. « Il se pourrait, déclara-t-il, que de ces négociations ne résultent que des aménagements qui prendraient la forme de transferts de pouvoirs vers le Québec ».
Dans un tel cas, de poursuivre Morin, « un gouvernement du Parti québécois ne se trouverait pas alors obligé de tenir un référendum pour faire approuver ces transferts » parce que « l’engagement à tenir un deuxième référendum ne vaut que si un changement de statut politique doit intervenir pour le Québec. Un tel transfert de pouvoir ne constituerait pas un tel changement ».
Il semblait bien que le Mouvement Desjardins était prêt à se satisfaire de ce simple transfert des pouvoirs. Son p.d.-g. Alfred Rouleau déclara qu’« aucun statut politique et aucun mode d’organisation ou de réorganisation de nos relations avec nos partenaires ne sauront effacer les contraintes économiques et culturelles de notre géographie ».
Alfred Rouleau tenait compte du fait que les seuls actifs de la Banque Royale dépassaient l’ensemble des actifs de toutes les institutions financières québécoises réunies. C’est sans doute cette position qu’exprimait également René Lévesque lorsqu’il parlait de « pondérer la parité » dans les institutions politiques. La proposition d’entente s’appelait « D’égal à égal », mais il semble bien que pour Lévesque, Morin et Rouleau le principe de l’égalité des nations pouvait souffrir d’une entorse étant donné la force économique respective des deux partenaires.
Mais le Canada anglais ne voulut rien savoir de la nouvelle entente proposée par le Parti québécois. Le Canada a été créé et s’est développé sur la base de l’oppression du Québec et il pensait pouvoir continuer à le faire. Tout fut mis en œuvre – propagande, intimidations, mensonges – pour faire échouer le référendum péquiste et profiter de la défaite du Québec pour centraliser les pouvoirs à Ottawa à la faveur du rapatriement de la constitution et l’inclusion de la Charte des droits et libertés.
Paradoxalement, Paul Desmarais écope également de la défaite référendaire. Il avait mis son empire de presse au service du camp du Non et il pensait sans doute pouvoir toucher une récompense à la mesure des services rendus lorsqu’il envisage de réaliser son vieux rêve de jeunesse, prendre le contrôle de la plus grosse corporation au Canada, le Canadien Pacific.
Pour arriver à ses fins, Desmarais s’allie à la Caisse de dépôt du Québec à qui il venait de céder le contrôle de la papetière Domtar. Desmarais avait besoin de l’aide de la Caisse, parce qu’il avait été contraint de signer un accord en vertu duquel il s’engageait à ne pas détenir plus de 15% des actions du Canadien Pacific. Mais Desmarais pouvait être délié de cet accord, si un autre actionnaire parvenait à détenir plus de 10% des actions. Desmarais sait pertinemment que seule la Caisse de dépôt peut franchir ce cap et c’est ce qu’il lui demande en échange de Domtar.
Mais quand la Caisse s’approche à quelques décimales du 10% fatidique, la direction du Canadien Pacific - dont le président du conseil d’administration est Ian Sinclair, le beau-père de Pierre Elliott Trudeau - tire la sonnette d’alarme et ameute Bay Street.
Le gouvernement fédéral est contraint par les milieux financiers ontariens de déposer un projet de loi sur la limitation de la propriété des actions de sociétés, mieux connu sous le nom de S-31, qui vise spécifiquement la Caisse de dépôt sans la nommer. Toute la communauté financière québécoise s’indigne et se mobilise contre le projet de loi. Mais Desmarais capitule et abandonne son rêve de prendre le contrôle du Canadien Pacific. Le projet de loi S-31 est retiré.
Desmarais se voit offrir, à titre de mesure compensatoire, un deuxième siège sur le conseil d’administration de l’entreprise. Éconduit pour la deuxième fois par l’élite financière canadienne – la première lors de sa tentative de prise de contrôle de Argus Corporation – Desmarais s’éclipsera quelque peu de la scène économique et politique canadienne au cours des années subséquentes pour concentrer ses activités en Europe où il se taillera un immense empire, avant de revenir plus tard avec son poulain Jean Chrétien à la tête du Parti libéral.
Le « bâton » et la « carotte » est une formule éprouvée en politique. Le mesures de guerre et l’intimidation fédérale ont forcé René Lévesque et l’élite québécoise à tendre l’oreille aux conseils « stratégiques » de Claude Morin. Pendant ce temps, Morin isolait la gauche au sein du Parti québécois, avec la collaboration des services secrets. Le report en fin de mandat du référendum permettait une transformation radicale de la base sociale du Parti québécois, de façon à faire accepter une démarche par étapes qui repoussait le référendum sur la souveraineté à un deuxième mandat, donnant ainsi trois chances aux forces fédéralistes de défaire le camp souverainiste.
Pendant que Morin manoeuvrait avec dextérité, Paul Desmarais remplissait la besace des principaux hommes d’affaires québécois en leur faisant miroiter la possibilité d’étendre leurs activités à la grandeur du Canada. Le message était clair : la menace de la souveraineté était bénéfique, mais sa réalisation serait néfaste. Notre élite était maintenant prête à croire Trudeau qui promettait de mettre sa tête sur le billot pour une réforme constitutionnelle dont ils pensaient qu’elle rencontrerait les demandes historiques du Québec. La plupart de nos hommes d’affaires se rangèrent donc dans le camp du Non dans l’espoir de lendemains qui chantent. Le réveil sera brutal.
Le mouvement nationaliste québécois – comme tout mouvement national – représente différents intérêts de classe souvent antagonistes. Bien que l’oppression nationale frappe toutes les classes de la société – à des degrés divers, bien entendu – les appétits de certaines classes ou couches sociales peuvent être rassasiés plus facilement et à moindre coût que d’autres. C’est d’ailleurs toujours la stratégie de la classe dirigeante de la nation dominante de faire des concessions à ses « junior partners » de la nation dominée. La plupart du temps, la classe dominante cherche également à corrompre une partie des milieux intellectuels et de la petite-bourgeoisie au moyen de bourses, de prix et d’honneurs.
Cette mécanique est bien comprise par l’élite économique et une bonne partie de l’élite intellectuelle québécoises qui savent habilement jouer les vierges offensées pour arracher des concessions à Ottawa. Leur démarche peut même prendre la forme de revendications constitutionnelles dont leurs adversaires fédéralistes leur feront rapidement comprendre qu’elles ne doivent pas provoquer de rupture entre le Canada et le Québec.
En fin de compte, seules les classes ouvrière et populaires, qui constituent la très grande majorité de la population, ont intérêt à mettre radicalement fin à l’ordre social existant. C’est pour cela que la revendication d’indépendance nationale assortie d’un projet de société social-démocrate est prometteuse de la mobilisation la plus large et la plus conséquente. Mais, encore faut-il que soit élaboré ce programme et qu’il soit porté par une direction politique autonome, ce qui a jusqu’ici toujours fait défaut.
Crédit photo : Power Corporation
Du même auteur
| 2024/04/17 | Ukraine : Boris Johnson a fait dérailler les négos de paix |
| 2024/03/22 | L’affaire Michaud : Une nébuleuse affaire |
| 2024/03/20 | Mulroney, le vrai bilan |
| 2024/03/20 | Mulroney et les trois accords |
| 2024/03/15 | Visitez le Vatican ! |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/04/17 | Yanis Varoufakis : Le discours que je n’ai pas pu prononcer |
| 2024/04/17 | Gaza : « Anatomie d’un génocide » |
| 2024/04/12 | La République du Québec est une valeur ajoutée |
| 2024/04/12 | Une entrevue avec M. André Messier |
| 2024/04/10 | Propulser les voix théâtrales |