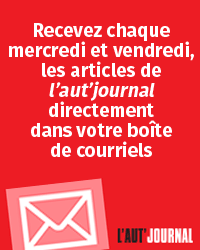Le 20 mai 1980, il y a quarante ans aujourd'hui, je n'ai pas été surpris du résultat parce que je l'avais vu venir. Je n'ai même pas été déçu en 1995, parce que là encore je croyais que nous allions perdre de peu. Je crois comme d'autres que le second référendum a vraisemblablement été volé. Ce qui m'a déçu dans les deux cas, c'est la gestion catastrophique de ces défaites référendaires par les gouvernements du Parti Québécois. 1980 pour moi ne faisait que mettre le projet sur la table. Le résultat de 1995 était si serré qu'il nous donnait le devoir de continuer. C'était un match nul et une demi-victoire; je n'en revenais pas que Bouchard y voyait une défaite, ce qui démontrait qu'il ne fallait pas faire l'indépendance avec des gens aux convictions aussi superficielles. D'autres peuples, les Irlandais par exemple, ont vu bien pire et n'ont jamais lâché.
Le 15 novembre 1976, j'étais assis dans notre salon familial à Ottawa. Après une enfance passée à Baie-Comeau sur la Côte-Nord, où mon père, le seul cadre francophone d'une importante compagnie forestière, m'a transmis sa profonde sympathie pour les Autochtones et m'a parlé d'un jeune étudiant en droit appelé Brian Mulroney, j'étais étudiant en sciences politiques à l’Université d'Ottawa. J'ai vu René Lévesque monter sur scène et dire: « Nous sommes quelque chose comme un grand peuple ». J'ai dit: « C'est à cela que je veux participer ». Lévesque venait de me donner le rêve de mes 20 ans. Je n'y ai jamais renoncé.
Je faisais une nette distinction dès ce moment entre parler de l'indépendance et contribuer à la réaliser. J'appartenais à une génération de verbomoteurs, mais je n'en étais pas un et j'en avais horreur. Je voulais me rendre utile. Deux ans plus tard, je suis entré à la faculté de droit de l'Université Laval pour me spécialiser en droit constitutionnel.
Le droit constitutionnel
En 1982, l'année fatidique du rapatriement de la Constitution canadienne, j'entrais à la Direction du droit constitutionnel du ministère de la Justice, grâce à l'appui du professeur Henri Brun, qui m'a initié (en 1980, justement) au droit constitutionnel et à qui je soumets encore parfois certains textes quarante ans après l'avoir rencontré, ce qui me rend un peu nerveux comme si je subissais un examen. (Heureusement, il aime en général.)
Le mandat de cette Direction est double: rédiger des avis juridiques pour les différents ministres et ministères et défendre les lois québécoises devant les tribunaux. Notre travail était très politique. Je me sentais comme un croisé. Mais le début de carrière fut rude: coupure de salaire de 20% à cause d'une terrible récession, et défaites successives jusqu'en Cour suprême qui charcutaient la loi 101. Nous avons marqué quelques points.
Par exemple, nous avons réussi à convaincre la Cour suprême que rien ne pouvait contrer la clause dérogatoire, ce qui demeure le précédent déterminant pour la loi 21. Mais dans l'ensemble ce fut difficile.
Après quelques années et le départ de Lévesque, j'ai eu envie de voir ailleurs. Le libre-échange avec les É.-U. était dans l'air du temps. Je suis allé faire une maîtrise en droit constitutionnel économique sur les implications du libre-échange pour le partage des compétences.
En 1988, je suis entré aux Affaires intergouvernementales, ou j'ai côtoyé sans en être membre l'équipe chargée du dossier du lac Meech. C'est là que j'ai rencontré mon ami Marc Chevrier, aujourd'hui professeur à l'UQAM.
La Commission Bélanger-Campeau
En 1990, quand la Commission Bélanger-Campeau est arrivée, j'ai démissionné et traversé la rue pour lui offrir mes services. Après un an à cet endroit, on me confiait des tâches plus importantes, notamment sur la validité juridique en droit international de la première étude sur le partage de la dette fédérale entre le Canada et le Québec indépendant.
Je suis allé ensuite à deux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, pour lesquelles j'ai servi de coordonnateur de la recherche politique et juridique. C'est alors que j'ai suscité la plus grande étude sur le territoire du Québec indépendant jamais réalisée. Elle fut l'oeuvre de cinq sommités du droit international, dont le président français de la Commission du droit international de l'ONU et une future présidente britannique de la Cour internationale de Justice.
J'ai longuement discuté avec eux à Paris et à New York. Ils ont conclu à l'unanimité que le Québec indépendant conserverait tout son territoire terrestre et en plus obtiendrait une extension considérable de son territoire maritime. Toute la propagande canadienne sur la partition est de la bouillie pour les chats et les droits autochtones, qui sont importants, n'y changent rien. Malheureusement, de nombreux Québécois, dont plusieurs indépendantistes, sont tombés dans le piège de la propagande fédéraliste, dont le seul but est de nous intimider.
Le référendum de 1995
En 1995, de retour au gouvernement, j'ai animé deux groupes de travail interministériel: dans le premier, j'ai rédigé un projet de Constitution du Québec indépendant; dans le second, un projet de Traité entre le Québec indépendant et le Canada. Le premier n'a pas été rendu public avant plusieurs années et le second ne l'a jamais été. Je considère qu'il faudra rendre de tels documents publics la prochaine fois. La seule disposition du projet de Constitution qui a été rayée par Jacques Parizeau est celle qui le nommait commandant en chef des forces armées du Québec, à l'instar du Président des États-Unis.
Je ne travaillais pas directement avec M. Parizeau à l'époque. Je l'ai connu plus tard, de même que son vice-premier ministre Bernard Landry. Je relevais plutôt du secrétaire général du gouvernement, Louis Bernard, qui avait joué le même rôle pour Lévesque en 1980 et à qui je demande toujours conseil à l'occasion. Il m'a demandé de ne pas dire ce que je faisais à ma ministre, qui était alors Louise Beaudoin. Peu de fonctionnaires ont reçu une telle directive.
J'ai aussi servi de conseiller juridique en 1995 à ce qui devait être l'équipe de négociation d'une centaine de personnes avec le Canada si le OUI l'emportait. Nous avons reçu des indications peu avant le 30 octobre qu'Ottawa et Toronto étaient prêts à négocier avec nous, séparément si nécessaire, et peu importe ce que leurs hommes politiques déclaraient publiquement. J'ai eu alors la certitude que le réalisme économique l'aurait emporté sur toute autre considération, notamment celles qui étaient relatives aux frontières du Québec.
J'avais des réunions régulières, présidées par Louis Bernard, avec trois autres sous-ministres triés sur le volet. De nombreuses questions fusaient vers moi: « André, qu'en est-il du Labrador, du contrat d'Hydro avec Terre-Neuve, des frontières dans le Grand Nord, de la double citoyenneté, etc.? » Je n'étais pas entièrement d'accord avec tout ce que le gouvernement décidait, et j'en tirais des leçons pour l’avenir.
De tous les ministres, seulement Parizeau et Landry savaient ce que nous faisions. Nous percevions des tensions très importantes au Conseil des ministres. Au départ, M. Bernard devait être le négociateur du Québec avec le Canada. À la mi-campagne, pour hausser les chances d'une victoire, M. Parizeau a annoncé que ce serait plutôt M. Bouchard. Ce dernier n'a jamais pris la peine de nous rencontrer et a fait savoir à son arrivée à la tête du gouvernement qu'il n'avait pas besoin de notre expertise. J'ai tout de suite compris qu'il n'était pas sérieux.
Un gain majeur à la Cour suprême
Je me suis dit que j'avais fait du chemin depuis mon salon de 1976. Et depuis le référendum de 1980 alors que, jeune étudiant idéaliste, je n'avais que distribué porte à porte des brochures pour le OUI. Par la suite, j'ai constamment mis à jour mes connaissances et je suis retourné devant la Cour suprême dans ce que le juge en chef de l'époque a appelé la plus importante cause de l'histoire canadienne: le Renvoi de 1998 sur la sécession du Québec.
À cette occasion, j'ai pu convaincre la Cour de créer une obligation constitutionnelle de négocier applicable à toutes les parties suite à une victoire du OUI dans un référendum; j'estimais que cette obligation était nécessaire parce que Trudeau et Chrétien avaient déclaré lors des deux campagnes référendaires qu'ils refuseraient peut-être d’accepter le résultat.
De plus, nous avons convaincu la Cour suprême qu'une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec pouvait être légale à la fois en droit international et en droit canadien. Bourgault et Parizeau ont très bien vu que ce jugement unique au monde était une grande victoire pour le cheminement vers l'indépendance, mais aucun gouvernement du Québec n'a depuis été à une hauteur suffisante pour en profiter. Plusieurs se sont laissés intimider par les mensonges de Stéphane Dion, avec qui j'ai eu la satisfaction de croiser le fer dans un colloque en 2013 pour le 15e anniversaire du Renvoi ou Daniel Turp m’avait invité. J'ai eu l'immense plaisir d'avoir le dernier mot.
Par la suite, j'ai bifurqué vers le droit autochtone, ma seconde passion professionnelle, tout en me disant que cette expérience pourrait aussi servir à bâtir des ponts au moment de l’indépendance. Plus récemment, j'ai libéré ma plume et ma parole afin de transmettre cette passion pour le Québec, particulièrement à une nouvelle génération.
Je vous prie d'excuser la longueur de ce texte. C'est parce que c'est le 20 mai.
Photo : Jacques Nadeau - ledevoir.com
Du même auteur
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/04/12 | La République du Québec est une valeur ajoutée |
| 2024/04/12 | Une entrevue avec M. André Messier |
| 2024/04/03 | Les Wpath-files – chronique d’un scandale médical |
| 2024/04/03 | Une entrevue avec Mme Michèle Brouillette |
| 2024/03/27 | Quatre luttes inspirantes |