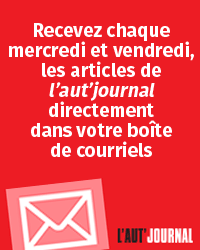Les littératures autochtones foisonnent et c’est tant mieux : la prise de parole littéraire précède toujours la prise en main politique. Contrairement à ce que l’on nous laisse croire, ils sont bien vivants, ces peuples. La longue lettre ouverte intitulée Shuni (Mémoire d’encrier), écrite à l’intention de son amie Julie par l’auteure innue Naomi Fontaine, permet d’en prendre la mesure.
Shuni, c’est Julie prononcée en innu-aiman. Mais Shuni, c’est aussi la personnification des Québécois. Si elle traite aussi de filiation, de vie privée et de rapports humains, cette lettre doit se lire comme un appel au dialogue entre Innus et Québécois, à la fin du colonialisme et à la quête identitaire.
Il y a une certaine naïveté dans le propos de Fontaine, mais une candeur qui n’est pas négative, celle d’une écrivaine qui pense loin des théories. Ici, c’est l’âme qui parle. De l’espoir, de la résilience et de la résistance.
Malheureusement, c’est parfois navrant. Par exemple, l’auteure présuppose la bonne entente entre les majoritaires et les minoritaires au Québec, ou encore entre les différents peuples autochtones, ce qui n’est pas toujours le cas. Et si Fontaine parle de notre colonialisme, jamais elle n’aborde celui que l’on subit. Pourtant, bien qu’à des degrés différents, nous avons en commun la domination canadienne. Si nous placions le portrait peint par Fontaine devant un miroir, nous pourrions facilement y voir notre reflet.
Néanmoins, le livre est beau et revigorant. L’assurance et la combativité de l’auteure n’y sont pas étrangères. Loin des statistiques et des spécialistes, Fontaine nous livre sa réalité en oscillant constamment entre l’agacement devant notre insistance sur son identité et le ravissement de la revendiquer. Cette ligne de tension traverse le livre en entier.
Elle présente les Innus comme un peuple foncièrement libre, avant comme après l’arrivée des Occiden-taux. Or, la venue de nos ancêtres a signifié le début du colonialisme : « Je finis toujours par m’excuser, affirme-t-elle. Une mauvaise habitude de colonisée ». Nous aussi, nous sommes polis envers le Canada depuis des lunes. Il faut se défaire de ce double colonialisme subi et imposé.
Si les Innus sont aujourd’hui officiellement « libres », ils demeurent mentalement colonisés, comme l’affirme l’auteure : « Les barrières les plus solides sont celles qui subsistent dans l’esprit ». Cela mène Fontaine à traiter des Blancs qui vont aider les Autochtones dans leur communauté : « Je sais que l’intention est bonne. Mais je sais aussi que ce n’est pas suffisant ».
L’image que nous projetons d’eux-mêmes accentue leur inconséquence sur le plan identitaire. Lorsque nous affirmons que les Innus sont résilients, nous utilisons un euphémisme qui cache une part d’ombre : « Ce n’est pas naturel qu’une personne reste ouverte à une société qui, durant plus d’un siècle, a tout mis en œuvre pour détruire sa culture. Ce n’est pas naturel d’écrire dans une langue coloniale, et de l’aimer ». Est-il plus normal pour nous, Québécois, de rester ouverts à l’anglais et au Canada ?
L’auteure ajoute : « J’ai grandi en croyant que de ne pas savoir lire et écrire l’innu-aiman était acceptable. (…) Aujourd’hui, je dois me défaire de mes idées rétrogrades (…) ». À son fils qui lui dit qu’il voudrait être blanc, elle brandit la fierté innue, mais confie que ce soir-là, elle a « pleuré [s]on envie d’être blanche ». À ce titre, combien de Québécois pleurent leur envie d’être anglophones ?
Les préjugés et le racisme envers les Innus sont encore légions, chape de plomb sur une fierté fragile. Mais Fontaine admet avoir elle-même eu des préjugés sur Haïti, image qu’elle a rectifiée en visitant Port-au-Prince. La connaissance de l’Autre ne peut faire l’économie de contacts humains soutenus : « T’écrire au nom de ce “ nous ”, c’est aussi me rappeler que ce “ nous ” n’existe que dans les discours. Chez moi, tu verras l’ensemble de l’identité innue, mais tu ne nous connaîtras réellement que lorsque l’ensemble s’effacera. Pour faire place à chacun d’eux ». Même si je ne crois pas que le « nous » ne soit qu’un discours – elle parle d’ailleurs abondamment au « nous » dans son livre – elle a raison d’affirmer que l’on ne peut réduire l’individu à sa communauté.
L’identité est certes multiple, mais la nation en est encore un fondement. Fontaine n’hésite pas à affirmer son attachement charnel et naturel à sa communauté. Lorsqu’elle aborde la raison des mariages entre Innus, elle mène cette réflexion : « Bien sûr, la loi nous y incite. Les contraintes des droits acquis dépendent de la pureté du sang (…) Toutefois, je ne crois pas que ce soit la raison première de ces unions-là. C’est sans doute différent pour chacun, mais il se peut qu’au-delà de la couleur de la peau, préférer se reconnaître dans les manières de l’autre soit une chose naturelle ». Il y a donc des raisons autres que racistes à rechercher la ressemblance plutôt que la diversité à tout prix, contrairement à ce que laisse entendre le dogme multiculturel.
Mais relisez bien ce passage. Nous en sommes encore à définir les Innus par leur sang ! Cette disgrâce est sans nom. Elle s’explique par notre vision déphasée de ces peuples que nous ramenons à une image mythique enfermée dans le passé.
La modernité, que l’on associe au rationalisme occidental, n’a pourtant pas été l’apanage de l’Occident : « Tu me croiras si tu veux, argumente-t-elle, mais la démocratie au lieu de la monarchie, l’égalité entre les hommes et les femmes, la liberté des êtres humains existaient déjà chez moi, depuis longtemps (…) Ce n’est pas la modernité qui nous a presque tués. C’est l’idée impossible qu’une race puisse être supérieure à une autre ». Mais la modernité dont elle se réclame se veut un entrelacs entre présent et tradition : « Je les [les Innus] aime, dit-elle, quand ils sont ouverts sur le monde. Je les aime quand ils sont attachés à la tradition ».
Fontaine aime le français et le Québec en même temps. Loin de la doxa de la gauche diversitaire qui prétend parler au nom des « minorités », Fontaine affirme dans un passage brillant : « Aussi improbable que ça puisse être, le nationalisme québécois a forgé mon esprit d’appartenance à ma culture. (…) Je crois moins au métissage des cultures qu’au reflet de soi dans l’autre. Le métissage comme un ensemble flou de pratiques culturelles prises ici et là qui parfois mènent les individus à renier leur héritage. (…) Je m’attache à la différence, parce que par elle, je réalise les spécificités de ma culture. (…) l’affirmation de sa culture précède l’ouverture à l’Autre ». J’ajouterais que c’est dans l’infiniment local que nous sommes universels.
L’amélioration de la relation Québécois-Innus pourrait être profitable à tous. Fontaine ose même poser la question : « [e]st-ce qu’un pays commun pourrait naître », est-ce qu’une deuxième rencontre serait possible ? Si elle doit avoir lieu, ce sera celle de la dernière chance, et elle ne pourra qu’être fatale ou libératrice pour les deux peuples. Dans la perspective de luttes parallèles, mais unies, il faut reconnaître notre ennemi commun : la Confédération.
Pour que le rapport entre les Innus et les Québécois s’égalise, il faudra que ces peuples soient libres : comment peuvent advenir l’égalité et le respect mutuel entre deux peuples dominés, surtout quand le premier est encore plus soumis que le second et que le second participe à la domination du premier ? Il n’y aura pas d’indépendance québécoise réelle sans une forme d’autonomie autochtone : notre décolonisation doit aller de pair.
Crédit photo : G.Garitan / CC / wikipedia.com
Du même auteur
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
| 2024/01/26 | De quel Godin te souviens-tu? |
| 2023/12/15 | La colère d’Octobre |
| 2023/12/13 | L’inflexibilité d’une CAQ à contre-courant |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/04/12 | La République du Québec est une valeur ajoutée |
| 2024/04/12 | Une entrevue avec M. André Messier |
| 2024/04/03 | Les Wpath-files – chronique d’un scandale médical |
| 2024/04/03 | Une entrevue avec Mme Michèle Brouillette |
| 2024/03/27 | Quatre luttes inspirantes |