
- Le Mouvement Québec français (MQF) exige du Conseil de la magistrature du Québec et des juges Rondeau et Hughes qu’ils se désistent immédiatement de leur pourvoi en Cour supérieure à l’encontre de la décision du ministre Jolin-Barrette d’éliminer le critère de la compétence en anglais comme condition formelle de la sélection des candidats à la magistrature à la Cour du Québec ;
- Le MQF exige que le projet de loi no 96 du gouvernement Legault revienne aux dispositions initiales de la loi 101 en matière de langue des pouvoirs législatif et judiciaire, afin de faire de notre langue nationale, le français, la seule langue officielle des lois et de la Justice au Québec, comme dans toute société linguistiquement normale.
Ainsi, les juge en chef et juge en chef associé de la Cour du Québec, Lucie Rondeau et Scott Hughes, rejoints par le Conseil de la magistrature (qu’ils chapeautent également) ont entrepris de faire casser la décision – ô combien judicieuse – du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, d'enfin éliminer le critère de la maîtrise de l'anglais comme condition formelle – et quasi systématique – de l'embauche des candidats à la magistrature en cette Cour autrement qualifiée, non sans raison, de « Cour provinciale ».
Ce faisant, les juges Rondeau et Hughes viennent s’immiscer, par la voie judiciaire, au cœur d’un débat lourdement politique qu’il ne leur appartient ni de trancher ni d’influencer. Car, la question du français, langue de l’État, constitue une matière d’intérêt national supérieur qui, clairement, échappe au cadre normal et ordinaire de leurs attributions en tant qu’administrateurs non élus du pouvoir judiciaire.
Par conséquent, il eût été de mise, pour la Cour et le Conseil, de faire preuve d’un tant soit plus de réserve, de retenue, ne serait-ce qu’au nom du bon sens, sachant bien que l’Assemblée nationale procède, en ce moment même, à l’étude d’une réforme sans précédent de la Charte de la langue française qui, en l’occurrence, aborde certains enjeux tout à fait identiques à ceux soulevés par le grief en question. Il faut en conclure que la magistrature a voulu prendre de l’avance sur le débat en cours devant le forum parlementaire, en choisissant de le mener, pour sa part, devant le forum judiciaire, plus familier.
Avec le projet de loi no 96, le gouvernement du Québec se propose, en effet, de consolider législativement le statut du français comme langue de l’État et donc de la Justice ; de renforcer le devoir d’exemplarité des autorités publiques et donc des tribunaux à cet égard ; de garantir l’exercice du droit linguistique fondamental de tous les Québécois à gagner leur vie en français, y compris dans le secteur judiciaire. L’idée étant de cheminer plus efficacement vers l’objectif élémentaire, qui consiste à faire du français la véritable langue officielle au Québec, tout en éliminant, autant que possible, les phénomènes d’anglo-bilinguisme institutionnel, si délétères pour le statut du français, et qui, partout en l’État, érigent la maîtrise de l’anglais au rang de condition sine qua non de l’accès à la sphère des élites, des décideurs, des titulaires de charges. Cette forme de ségrégation diglossique, qui peut aller jusqu’à priver certaines personnes d’occuper certains postes du seul fait qu’elles n’auraient pas appris à speak white fluently. Voilà précisément ce que les juges Rondeau et Hughes, par leur pourvoi, cherchent à cristalliser une fois pour toutes dans les pratiques de la Cour du Québec.
Autrement dit, un juriste aura beau présenter le meilleur CV de sa profession ; arborer le titre d’advocatus emeritus ; posséder trois baccalauréats, deux maîtrises et autant de doctorats ; toujours est-il que de toutes les compétences, la seule qui vaille vraiment, le seul critère éliminatoire, c’est de savoir l’anglois. Être ou ne pas être anglobilingue, telle est, en effet, la question.
Concrètement, pensons au cas d’un procureur d’origine berbère aspirant à devenir juge, et parlant quatre langues : le français, le kabyle, l’arabe et l’espagnol, mais – ô sacrilège – pas l’anglais. Celui-là pourrait donc, en principe, n’avoir d’autre choix que d’abandonner son rêve, ou alors retourner sur les bancs d’école pour acquérir l’anglais. Tout cela, dans une société ayant supposément le français comme seule langue officielle.
Au lire de ce pourvoi daté du 4 novembre, d’aucuns se montreront peut-être sensibles aux préoccupations logistiques des demandeurs. Certes, l’anglo-bilinguisme institutionnel, imposé de force par l’État canadien, rend toute chose infiniment plus compliquée dans la gestion courante des affaires de l’État. Il n’empêche qu’à comparer au Parlement, la magistrature ne possède ni la légitimité démocratique ni la hauteur de vue suffisante pour venir entraver de la sorte l’atteinte des objectifs de la loi 101, lesquels relèvent non des impératifs bureaucratiques de la juge en chef de la Cour provinciale, mais bien de l’intérêt national supérieur. En cela, lorsque le ministre de la Justice, qui est aussi le ministre de la Langue française, s’est résolu à rayer le critère de la compétence en anglais dans trois avis de sélection à différents postes de juges, il n’a fait que veiller, tout simplement, au respect de ces objectifs supérieurs, et notamment à la protection des droits linguistiques fondamentaux.
En Ontario ou au Manitoba, par exemple, impose-t-on formellement et systématiquement aux juges des judicatures inférieures de posséder une autre langue que la langue de la majorité aux fins de l’exercice de leur profession? À l’évidence, la réponse est dans la question.
De tous les États non officiellement bilingues au Canada, il n’y a que le Québec où une telle exigence s’avère aussi répandue, et cela bien au-delà des seuls endroits « où le nombre le justifie[rait] ». À ce chapitre, faut-il rappeler que la communauté d’expression anglaise, surtout concentrée à Montréal, compte en réalité pour moins de 8,1 % de la population du Québec? Comment une aussi petite minorité peut-elle parvenir à bilinguiser tout un système? Cela dépasse l’entendement. D’ailleurs, parmi les avis de sélection auxquels s’attaquent aujourd’hui les juges Rondeau et Hughes, deux sur trois concernent en l’occurrence des districts judiciaires où l’anglais, langue maternelle, représente une part encore plus infime de la démographie linguistique, à savoir : Joliette, Labelle, Laval et Terrebonne.
Cela dit, même à Montréal, l’obligation formelle de bien manier l’anglais pour devenir juge ne saurait prévaloir davantage sur le principe du français, langue officielle, non plus que sur le droit fondamental à la non-discrimination linguistique à l’embauche. L’officialisation de cette pratique est d’autant plus insensée que dans les faits, chacun sait bien que la population en général, et les juristes en particulier, affiche déjà un taux très, très élevé d’anglo-bilinguisme individuel ; peut-être le plus élevé au monde. Difficile de croire au défi logistique, apparemment insurmontable, qui consisterait – ô misère – à trouver un juge anglobilingue pour entendre un justiciable anglophone lorsque le besoin s’en fait sentir.
A-t-on oublié, par ailleurs, la possibilité de recourir à des interprètes judiciaires, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’entendre un témoin? Assurément, le métier d’interprète, qui hérite d’une tradition séculaire au Québec, mériterait d’être valorisé davantage, d’autant qu’il permet d’offrir à des allophones la possibilité de s’exprimer dans leur langue maternelle, plutôt qu’en anglais, ce qui va dans le sens, tout à la fois, de l’intérêt de la justice et de l’unilinguisme officiel qu’il nous faut atteindre. À ce titre, il faut dire qu’en pratique, comme dans d’autres secteurs de la vie publique, on a bien souvent tendance, au tribunal, à assimiler tout allophone non francisé à un locuteur anglais ; et donc à lui faire subir son procès en anglais ; et donc à tout angliciser l’instance, au motif que ce justiciable baragouinerait un peu mieux la langue de Durham que celle de Papineau.
Plus globalement, compte tenu de la force d’attraction objective de l’anglais, surtout à Montréal, l’anglo-bilinguisme étatique que promeut ici la Cour du Québec, condamne le français, à terme, à un rôle de langue superflue, inutile, de second ordre ; minant ainsi tout espoir d’en garantir le statut et la vitalité dans la durée. Cette vision – proprement canadienne – de la dynamique des langues au Québec, qui consacre le libre-choix linguistique et où l’anglais fait toujours figure de « default language » ; cette vision fédérale vient totalement éclipser la vision québécoise des choses, outre qu’elle vient annihiler plus de 40 ans de tentatives de reconfiguration institutionnelle en faveur du français. L’objet premier de la politique linguistique québécoise consiste à faire de notre langue nationale, le français, la langue d’adhésion normale et naturelle des nouveaux arrivants. La réalisation de cet objet implique l’aménagement d’un environnement linguistique normal au Québec, qui suppose à son tour que nos institutions – dont nos cours de justice – soient organisées de manière à y concourir activement, à l’instar de n’importe quelle société linguistiquement normale. Or, ce que font les juges Rondeau et Hughes, revient tout bonnement à saboter cette quête si névralgique de normalité, en privilégiant plutôt la première vision, celle d’Ottawa – celle qui nous anglicise, à la seconde.
Pour toutes ces raisons, le MQF exige du Conseil de la magistrature du Québec et des juges Rondeau et Hughes qu’ils se désistent immédiatement de leur pourvoi qui n’a pas lieu d’être.
À la fin des années 1970, les arrêts Blaikie de la Cour suprême ont rapidement invalidé, en vertu d’une interprétation pour le moins acrobatique de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, les dispositions originelles de la loi 101 qui faisaient du français la seule langue officielle de la législation et des tribunaux. Depuis, outre une décision de l’ancien juge Baudouin de la Cour d’appel, cassée en Cour suprême, voulant qu’en cas de divergence d’interprétation, la version française d’une loi québécoise doive être préférée à sa version anglaise, rares sont ceux ayant eu le courage de ramener cette question à l’ordre du jour politique.
Récemment, dans un ouvrage préfacé par le même Jean-Louis Baudouin, les juristes François Côté et Guillaume Rousseau ont prôné un renversement de paradigme à ce chapitre. L’article 5 du projet de loi no 96 qui, entre autres, confère une préséance interprétative à la version française de nos textes de loi, et qui protège le droit de tous magistrats (dont la nomination relève de Québec) de travailler en français, va dans ce sens et mérite d’être salué.
Mais, il y a lieu d’aller plus loin – il faut aller plus loin – en rétablissant les dispositions initiales de la loi 101 qui faisaient du français la seule langue officielle des pouvoirs législatif et judiciaire. Il en va non seulement du statut de notre langue nationale en tant que langue de l’État – notion fondamentale, mais plus encore, du principe démocratique lui-même.
Car, si doctes soient-ils, quelques juges non élus de la Cour suprême du Canada ne font pas le poids, en termes de légitimité, pour dicter sa conduite à une assemblée souveraine agissant dans l’intérêt vital et supérieur d’un peuple, au nom de ses droits inaliénables. Cela est d’autant plus juste que la plupart des provinces canadiennes, l’Ontario au premier chef, n’ont aucune obligation équivalente à celles qui s’imposent au Québec en vertu de la jurisprudence constitutionnelle relative à l’article 133. Le plus ironique, c’est que cet article fait partie d’un texte – la Loi de 1867 – qui n’a encore pour seule version officielle, que sa version anglaise !
Si le gouvernement Legault croit vraiment au fédéralisme, ce qui n’est certes pas le cas des auteurs de ce texte, alors on ne voit pas ce qui l’empêcherait d’emprunter les moyens politiques qui s’imposent pour forcer Ottawa à accepter une révision constitutionnelle bilatérale du fameux article 133 afin de faire prévaloir le français comme seule langue officielle des lois et des tribunaux du Québec.
Plus généralement, à défaut pour la CAQ d’honorer son obligation de résultat en veillant à garantir, au strict minimum, le maintien du statut et du niveau de vitalité démographique du français, il s’ensuit que le nationalisme fédéraliste ne peut plus sérieusement se présenter, pour quiconque, comme une solution crédible au déclin de la nation québécoise dans le cadre canadien. D’ailleurs, le MQF estime qu’il ne l’a jamais été. La différence cette fois, c’est que ce constat sera désormais évident aux yeux de la population, la loi 96 ayant été comme un chant du cygne pour une certaine idée québécoise du Canada. C’est-à-dire que tous les observateurs sérieux n’auront d’autre choix que de reconnaître, chiffres à l’appui, que les fédéralistes, fussent-ils caquistes, libéraux ou autres, ont tous perdu leur pari. Et qu’en toute honnêteté, seule l’indépendance nationale du Québec peut garantir le salut du français en ce continent.
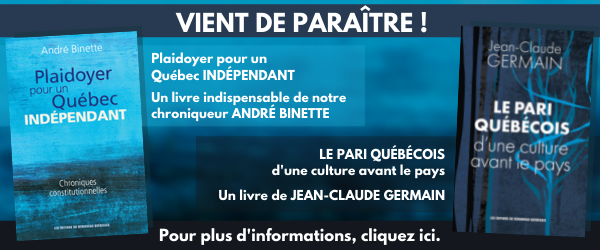
Publicité : Livres d'André Binette et de Jean-Claude Germain https://lautjournal.info/































