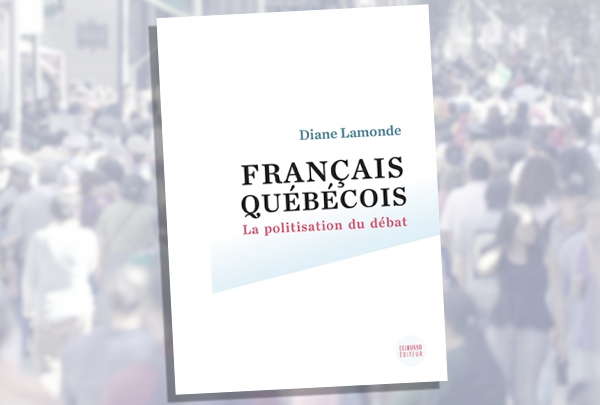
Rares sont les ouvrages sur le français écrit au Québec qui sortent de nos jours du milieu restreint des linguistes. Pourtant la question mérite réflexion et l’on ne peut qu’accueillir avec intérêt la publication de l’essai Français québécois. La politisation du débat de Diane Lamonde, qui nous aide à comprendre la complexité de notre rapport au français.
Se tenant aujourd’hui généralement loin des projecteurs, un débat fait pourtant rage depuis un demi-siècle entre les « aménagistes », tenants de la création d’une norme du français écrit au Québec – le français québécois –, et ceux qui affirment qu’il n’existe qu’une seule norme valable, celle de la France. Les premiers travaillent à la création du dictionnaire Franqus, que les seconds attaquent allègrement.
L’intérêt premier de l’essai de Lamonde tient dans la destruction en règle des arguments de ces derniers qui défendent une position politique qui a peu à voir avec la linguistique. Politisant sans cesse le propos des « aménagistes », qui sont souvent effectivement nationalistes, ces critiques cachent en fait mal leur antinationalisme radical. Le nationalisme, résume-t-elle à raison, n’est pas a priori condamnable : tout dépend de ce qui s’y trouve.
L’argument principal des détracteurs est toujours le même : l’établissement d’une norme québécoise reviendrait à enfermer le Québec, à le couper du monde. On entend là en écho l’argument politique fédéraliste habituel. Lamonde montre qu’il n’en est rien puisque la codification d’un français québécois serait fortement alignée sur le français de l’Hexagone. Comment, en fait, pourrait-il en être autrement ? Tant en linguistique qu’en politique, le particulier ne s’oppose pas à l’universel, il en est plutôt le ferment.
Il est tout de même fascinant, le cas du Québec demi-peuple : les fédéralistes sont incapables de réfléchir au bien-fondé d’établir – ou non – une norme du français québécois. Ils ridiculisent les positions adverses, sans s’aventurer dans un débat réel. Tout comme il leur apparaît condamnable de chercher à enseigner davantage l’histoire du Québec. Les deux procédés inspireraient, croient-ils, des visées indépendantistes aux Québécois. Plutôt que de leur rappeler leur unicité, il faudrait leur cacher qui ils sont …
Logique tordue, s’il en est, puisque ces deux outils identitaires sont nécessaires pour établir notre rapport au monde. La logique fédéraliste est donc risible : le peuple québécois ne mérite tout bonnement pas d’exister et doit se fondre dans la « grande » nation canadienne. Il faudrait nier qui nous sommes et vivre une demi-existence canadienne bilingue.
Cependant, et c’est le second intérêt de l’ouvrage, Lamonde montre que l’idée, de prime abord alléchante, de codifier le français québécois, même en ne l’éloignant que très peu de la norme internationale, n’est pas aisément réalisable. Instituer une norme, c’est d’abord se poser la question de la légitimité.
Le français que l’on juge soutenu au Québec, affirme l’essayiste, est en fait truffé d’anglicismes, de calques et d’impropriétés, même dans les pages du Devoir … et dans les départements de linguistique. Alors, demande-t-elle, où légitimer la norme, quand même les « élites des élites » écrivent avec difficulté le français standard ? S’en éloigner reviendrait, à moyen terme, à fragiliser notre langue et à risquer la créolisation.
Si, objectivement, rien ne permet de dire que le français de France est supérieur aux autres français, l’Hexagone demeure, pour des raisons historiques et démographiques, la principale source de légitimité. Ce qui ne veut pas dire que les Français n’agissent pas souvent en impérialistes de la langue. Et il faudra bien que l’Académie française fasse plus de place en son sein à la diversité des langues françaises.
Cela pose la question de notre rapport à la France, aujourd’hui publiquement occultée. Les détracteurs du français québécois affirment que les « aménagistes » sont poussés par une francophobie latente, ce que dément à juste titre Lamonde. Chose certaine, les linguistes devraient prendre en considération que la culture française n’est plus un point de comparaison pour les jeunes générations.
Longtemps considérée comme un paradis perdu, la France – et sa langue – n’attire plus à l’époque Netflix. Pendant que les spécialistes se disputent au sujet de la norme, ils devraient plutôt s’attarder aux locuteurs qui délaissent de plus en plus leur langue maternelle, quelle que soit la source de légitimité.
Si je peine à me faire une tête sur cette question complexe, l’antinationalisme primaire des détracteurs me rappelle que la culture, dont fait partie la langue, ne peut se penser hors du politique. Lorsque l’on se contente, comme on le fait trop souvent ici, d’un nationalisme culturel, on se méprend sur la portée de la défense et de la promotion de notre culture. Le Québec-province ne sera toujours qu’une demie-culture encadrée, dirigée, envahie, subordonnée à l’intérêt et à la vision du monde d’une autre demie-culture, canadienne cette fois. On peine encore à prendre la pleine mesure de la marque indélébile léguée par 250 ans de colonialisme anglo-saxon et par l’impérialisme américain.
La division – qui se lit partout dans notre histoire et notre identité, comme l’a résumé Yvan Lamonde dans Un coin dans la mémoire (Leméac) – se trouve jusque dans la langue, nous dit en somme la linguiste, c’est-à-dire au cœur de notre identité. Gérard Bouchard remarquait, à juste titre, dans Genèse des nations et des cultures du Nouveau Monde (Boréal, 2001), que « le Québec se signale comme étant une des rares cultures fondatrices à ne pas avoir fait son choix [au sujet de la norme à adopter], étant profondément divisée entre diverses variantes du français parisien, international et québécois ».
De ce fait, l’écriture ne va toujours pas de soi pour un Québécois. Après un demi-siècle d’efforts herculéens pour nous éloigner du joual, nous n’arrivons toujours pas à choisir notre allégeance. Il y a, là comme ailleurs, problème de filiation. Et ce n’est pas parce que les auteurs actuels ne s’intéressent pas à cette question existentielle et que les débats publics sur le sujet sont inexistants que la situation est réglée. Elle est, à l’image de notre conscience, tout simplement refoulée.
À quelques reprises, la linguiste affirme que la survie du français dans ce presque-pays n’est plus menacée, que c’est plutôt la qualité de langue qui l’est. Si l’on suit jusqu’au bout la logique de son argumentaire, on en vient à accepter que le français québécois, une version abâtardie du français standard mal maîtrisé par ses élites mêmes, se transforme éventuellement, sans un sérieux coup de barre, en créole. Mais j’aimerais qu’elle explique comment nous pourrions nous éloigner à ce point des autres francophones à une époque de mondialisation. Sur ce point, l’essayiste est muette, tout comme sur la possibilité d’améliorer notre connaissance de la langue française.
Si le français se créolise un jour, c’est que les Québécois auront refusé de s’affirmer en tant que peuple. Ce créole ne sera plus la langue publique du Québec devenu simple province comme les autres, mais la langue pittoresque de l’ethnie locale, comme c’est le cas dans plusieurs anciennes colonies. Les langues disparaissent d’abord pour des raisons politiques.
Néanmoins, il me semble que l’avenir de la langue française au Québec passe nécessairement par une grande proximité avec la norme française et je vois mal ce que la création d’une norme québécoise changerait quant à la question de notre survie. Notre rapport à la langue de l’Hexagone interroge notre rapport à l’universel. Si la langue française est un marqueur fort de notre identité particulière, elle doit aussi être un ancrage dans l’universel, sous peine de se voir folklorisée.
Diane Lamonde, Français québécois. La politisation du débat, Montréal, Del Busso, 2018.
Du même auteur
| 2024/04/26 | Incarner le Québec qui s’américanise |
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
| 2024/01/26 | De quel Godin te souviens-tu? |
| 2023/12/15 | La colère d’Octobre |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/05/10 | Français : Tous les indicateurs sont au rouge |
| 2024/05/10 | Le Plan de la CAQ pour la langue française |
| 2024/05/08 | 10101010101010101 |
| 2024/04/10 | Le bilinguisme territorial, un crime contre l’humanité ? |
| 2024/03/22 | Une négation fallacieuse du déclin du français |
































