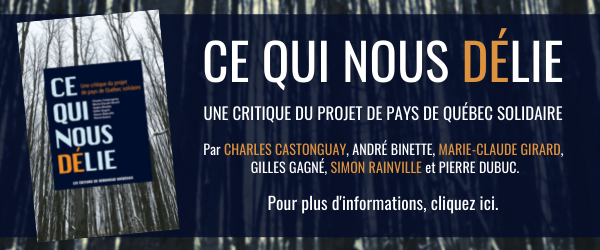Longueur: 2 923 mots
« Je pense, disait en 1984 le sculpteur et dessinateur animalier Robert Hainard, que les mouvements écologistes souvent s’écartent beaucoup du besoin de nature tout simple pour faire entrer dans les revendications écologiques toutes sortes de revendications personnelles, souvent névrotiques. Et pour moi le centre, c’est quand même la conservation de la nature sauvage et libre. »
J’ai repensé à Hainard lorsque j’ai vu le documentaire La panthère de neiges de Marie Amiguet, réalisatrice, et Vincent Munier, grand photographe animalier, mais qui est beaucoup plus encore. On reproche souvent à Munier, dont Hainard est une influence directe, de ne pas faire d’œuvres engagées, de ne pas profiter de sa tribune pour parrainer une cause. C’est ne rien comprendre à sa démarche. Son œuvre se situe à un autre niveau : montrer la beauté du monde, rappeler le « besoin de nature » de l’humain qui doit se réinsérer dans le vivant. Quelles causes pourraient-ils alors défendre? Ce n’est pas la survie d’une espèce qu’il souhaite, mais bien retrouver l’attention au vivant. Savoir regarder, s’arrêter, contempler, pour enfin respecter cette logique simple : nous ne sommes pas seuls sur cette planète.
Pour comprendre son approche, il faut voir la tristesse et la douleur dans son regard lorsqu’il confie, d’une voix douce, dans un rare moment de dévoilement, que la destruction du vivant le chavire : « C’est assez viscéral (…) Ça m’a construit. Et quand tu vois que ce monde-là part, comment dire, en vrille, non ce n’est pas en vrille … en décrépitude. C’est intérieur, ça te fait super mal. Et donc, j’ai besoin du Kamtchatka, le Grand Nord, là où il n’y a quasiment plus de présence humaine, ou alors les nomades, comme ici, qui vivent en harmonie, finalement. C’est vraiment le mot … que l’on n’a plus. »
Munier est à la recherche d’un autre rapport au monde. Il note cette anecdote dans son carnet d’affût de la panthère des neiges, Tibet: promesse de l’invisible : «L’homme nous dira que les loups lui tuent trente brebis par an, soit 10% de son cheptel. Lui l’accepte. La part des bêtes». Dans une autre entrée, il confie: « Je ne vois rien … et ne verrai rien d’autre. Journée sans photos, mais de magnifiques images sont là, quelque part dans mon imaginaire. Je me sens comblé. Entier. Vivant. Je me sens appartenir organiquement à cette Terre. Libre. Sans triche, ni artifice ». Et il ajoute : « Le bien-être trouvé dans la nature tient sûrement son origine dans la complicité de notre espèce avec toute l’histoire du vivant. Le sentiment d’appartenir à cet ensemble me procure un véritable apaisement. » C’est cette complicité qui le guide.
L’affût, la lenteur et l’attente comme antidote à nos sociétés pressées
Le documentaire fait suite à la publication de deux œuvres aux titres éponymes: un récit de l’écrivain Sylvain Tesson et un recueil de photographies de Munier. Leur aventure est en apparence simple et banale : chercher à voir la panthère des neiges du Tibet. Je dis « simple et banale » puisqu’en cette ère de satellites, de jeux vidéo et de « réalités augmentées », que peut bien peser la vue d’une bête? Et, devant la logorrhée de pamphlets écologistes, l’aventure semble dérisoire. Et pourtant, c’est à la fois une leçon de photographie, de cinéma, de littérature et d’écologie qui sort de cette aventure.
Le montage du documentaire est ainsi fait qu’il n’y a qu’une longue montée, qu’une longue attente, qu’un long affût, qui culmine avec l’arrivée de la panthère, que Tesson nomme « apparition religieuse » dans son livre. La panthère arrive, théâtrale, sûre d’elle-même, de « son pouvoir », dit Tesson, de sa grâce. Elle est là où elle doit être, « elle accomplit sa part de beauté », comme le disait Aristote cité par l’écrivain.
Le documentaire, entrecoupé de passages du livre de Tesson, qui prennent un autre sens puisque appuyés par les images, est sans artifice, mais il est d’une efficacité remarquable. Soutenu par la trame sonore de Warren Ellis et Nick Cave, qui appuie juste suffisamment l’émotion, nous assistons à une chose rare: l’apparition de la beauté, de la vie, du détail du monde. Le film débute sur l’image de Tibétains en pleine conversation, sans sous-titres, puis sur une meute de loups qui attaque un yack. Nous sommes loin du monde occidental, des villes, des questions postmodernes. Nous sommes au cœur du mystère de la vie.
C’est à la recherche de quelque chose qui dépasse nos envies, nos désirs, nos servitudes et nos problèmes humains que convie le film. « Aussitôt que nous l’apercevions, explique Munier, une paix montait en nous, un saisissement nous électrisait. L’excitation et la plénitude, sentiments contradictoires. Rencontrer un animal est une jouvence. L’œil capte un scintillement. La bête est une clef, elle ouvre une porte. Derrière, l’incommunicable. » « C’est un cadeau, mais un cadeau inespéré », renchérit Munier, le visage rayonnant. L’échange de regards entre Tesson et lui dit tout : un lien s’est créé grâce à l’attention au vivant.
Le film est par ailleurs esthétiquement très réussi, surtout si l’on considère les difficultés d’un tournage dans de telles conditions en équipe réduite. La crise écologique est d’abord une crise de la sensibilité de nos sociétés technologiques désenchantées et coupées du réel, comme l’expliquent depuis des années Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual. Le documentaire est un antidote. Il apaise, il nourrit et favorise notre adhésion au monde, ce qui n’est pas rien en ces temps difficiles. Il est un éloge de la lenteur, de la patience, de l’apprentissage du regard. C’est l’application de la sociologie de la lenteur d’Harmurt Rosa qui appelle à rendre le monde indisponible, à retrouver la résonance du monde.
Tesson explique : « On attendait une ombre, en silence, face au vide. C’était le contraire d’une promesse publicitaire : nous endurions le froid sans certitude d’un résultat. Au ‘’tout, tout de suite’’ de l’épilepsie moderne, s’opposait le ‘’sans doute rien, jamais’’ de l’affût. Ce luxe de passer une journée entière à attendre l’improbable! Je me jurais, une fois rentré en France, de continuer à pratiquer l’affût (…) Et si rien n’arrivait, la qualité du temps passé s’était trouvée accrue par l’attention portée. L’affût était un mode opératoire. Il fallait en faire un style de vie. »
Munier, depuis deux décennies, sonde la planète à la recherche de ces moments de beauté et d’apaisement. Sa technique, l’affût, lui permet de faire des clichés facilement reconnaissables dans une marre de plus en plus grande de photographes animaliers. Son regard est unique, son regard est plus qu’artistique. « Munier avait fait de l’affût une esthétique en même temps qu’une philosophie », dit Tesson. Son regard est une invitation à voir autrement, à voir le point de vue des bêtes. Munier a, pourrions-nous dire d’un point de vue culturel, une vision mystique. Mais nous pouvons aussi dire qu’il est à la recherche de la communauté de tout ce qui est vivant.
Et le documentaire porte cette marque, ce regard unique, plus grand que lui-même. Il dira en entrevue que la photo est un prétexte pour être là où il doit être. Le respect de la nature de Munier et d’Amiguet, qui n’interviennent jamais sur les scènes et respectent une distance avec les bêtes, est récompensé. Non seulement ils verront la panthère, mais elle semble même collaborer, d’une certaine façon, avec eux. Elle sait, sans aucun doute, qu’elle est observée, mais elle se laisse saisir par leurs objectifs, sachant qu’ils ne sont pas une menace. Elle ira même jusqu’à faire une apparition théâtrale, alors que seule la queue est d’abord perceptible. Du cinéma quoi. Elle ira même jusqu’à se coucher, directement au centre du cadrage d’Amiguet. Comme si c’était planifié, scripté. Elle apparaît même devant la caméra d’observation laissée par Munier. Si sa connaissance de la nature augmente les chances d’un tel exploit, il est tout de même remarquable qu’elle « collabore » à ce point, choisissant d’apparaître à cet endroit précis alors que son territoire fait des dizaines de kilomètres.
La scène que je préfère est celle où Munier et Tesson filment et photographient trois ours du Tibet. Plus les ours approchent, plus Tesson se sent petit, plus il somme Munier de partir, lui qui, fin connaisseur, sait qu’ils peuvent encore observer, un peu plus, ces animaux sauvages. Puis, vient le moment où il alerte son comparse : il faut partir, maintenant. L’humain n’a plus sa place. Ou plutôt, il est remis à sa place. Les plans du film ramènent très souvent l’humain à sa juste place, soit comme un détail dans cette nature grandiose. Les animaux aussi sont à leur place. L’humain et l’animal sont généralement très petits dans les plans : c’est la montagne, la steppe qui sont maitres en ces lieux. Munier rappelle souvent en entrevue qu’il aime se sentir fragile, vulnérable dans la nature, que cette humilité lui fait du bien, qu’elle pourrait en faire autant à la race humaine tout entière. Reprendre notre place, voilà un beau projet.
La nature et la culture, et par-delà
Rarement aurons-nous vu un tel exploit : d’un même événement, trois œuvres puissantes, d’égale valeur, sont nées. Ce qui fascine, lorsqu’on les compare, c’est leur perspective distincte, mais complémentaire. Les photos de Munier donnent à voir son point de vue naturaliste tandis que le livre de Tesson est une réflexion où s’entremêlent plusieurs considérations. Le documentaire présente davantage le point de vue Munier (et d’Amiguet), mais il présente un échange, sincère, vrai. Il permet la rencontre de l’œuvre de Tesson, de son écrit personnel, et de celle de Munier, de son travail de photographe animalier. Rencontre, en quelque sorte, de la nature et de la culture, de l’écrit et de l’image, du poète et du photographe, de deux mondes qui communiquent : Tesson parle de littérature, de religion, de société alors que Munier ramène tout aux animaux, au paysage, à l'habitat. « Il voyait, dit Tesson dans son livre, dans le taureau l’âme du monde, le symbole de la fécondité. Je lui racontais que les Grecs antiques les égorgeaient pour offrir le sang aux esprits souterrains, la fumée aux dieux et les meilleurs quartiers aux princes. Les taureaux faisaient intercession, le sacrifice valait l’invocation. Mais Munier s’intéressait au temps de l’âge d’or, précédant les prêtres ».
L’œuvre de Tesson est une réflexion métaphysique sur la vie et la mort, une méditation sur l’amour pour une femme et l’amour pour sa mère, toutes deux perdues, mais aussi une conversion, au sens religieux, une épiphanie. Le film conserve surtout cette conversion de Tesson-culture à la nature en même temps que Munier-nature profite de la culture littéraire. Ce que montre à voir le film, c’est qu’il est inutile et absurde de chercher à jouer l’un contre l’autre comme certains le pensent. Se reconnecter à la nature ne signifie pas se déshumaniser. Au contraire. L’attention à la première favorise le respect de l’humanité, et vice versa.
Au point de vue de Munier et Tesson, il faut ajouter celui d’Amiguet, qui filme les non-dits, les regards humain et animal, l’immensité de l’incommensurable. Si le film est signé Amiguet et Munier, la caméra, la matière première du montage, est de l’œil d’Amiguet. Les réactions de Tesson, par exemple, ajoutent à son récit et montrent un regard qui se transforme, une action qui s’affermit et prend de l’assurance, qu’on ne peut que soupçonner dans son livre. Et ses réflexions dans l’action, spontanées, loin des commentaires écrits passés dans le tordeur de la littérature, dévoilent son affection grandissante pour le milieu naturel et son émerveillement. « On n'est pas bien, là? », dit-il après ce que nous devinons être quelques jours passés dans les confins du Tibet. On sent bien la « conversion » de Tesson, plus encore que dans son livre, par la force des images, des non-dits.
Tesson, un écrivain louangé, est comme un enfant dans un monde qu’il ne connait pas, celui de la nature. Tesson est émerveillé par Munier, par son savoir: « Partout où son regard se posait, il voyait des bêtes ou devinait leur présence. Et ce don, comparable à l’éducation du passant raffiné qui, déambulant dans la ville, vous signale une colonnade classique, un fronton baroque, un rajout néo-gothique, offrait à Munier de se déplacer dans une géographie sans cesse enluminée et toujours généreuse, palpitant d’habitants dont un œil profane ne soupçonnait pas l’existence ».
Le regard de Tesson demeure néanmoins, dans son récit, celui d’un littéraire, celui de la culture. Il y va de belles fulgurances dont lui seul a le secret : « La dégradation du monde s’accompagnait d’une espérance frénétique en un avenir meilleur. Plus le réel se dégradait, plus retentissaient les imprécations messianiques. Il y avait un lien proportionnel entre la dévastation du vivant et le double mouvement d’oubli du passé et de supplique de l’avenir ».
Si l’œuvre de Tesson renferme des passages désabusés, voire cyniques sur la condition humaine, celle de Munier en est exempte. Elle est un don absolu parce qu’elle est au-delà de la morale et des débats sociaux. Elle se situe ailleurs : dans la compréhension du monde d’avant le néolithique. Ainsi, Tesson voit des parallèles avec l’humanité à chaque détour. Par exemple, il affirme : « Chaque troupeau se frôlait, aucun ne se mêlait aux autres et les ânes filèrent sans déranger personne. Chez les bêtes, on voisine, on se supporte, mais on ne copie pas. Ne pas tout mélanger : bonne solution pour la vie en groupe ». Entre de mauvaises mains, ce passage pourrait porter à croire que l’humain, comme les animaux, ne serait pas tenu à la fraternité entre les peuples. C’est vite oublier que la règle de la nature est tout autant l’entraide que la prédation. Munier ne pourrait dire une telle chose pour la simple raison qu’il ne projette pas l’humain dans les animaux. Les animaux sont ce qu’ils sont et aucun anthropomorphisme n’est possible. Au contraire, Munier est jaloux de l’agilité animale et attristé de notre perte d’animalité. « Tous nos sens ne travaillent pas suffisamment », conclut-il. Nous sommes les lourdauds de la nature et nous ne devrions pas en être fiers.
On sent que Tesson cherche une voix pour parcourir cette autre voie. Il affirme, au courant de l’aventure : « je m’acquittais de mon ancienne indifférence par le double exercice de l’attention et de la patience. Appelons cela de l’amour ». Puis il ajoute : « Avec Munier, je commençais à saisir que la contemplation des bêtes vous projette devant votre reflet inversé. Les animaux incarnent la volupté, la liberté, l’autonomie : ce à quoi nous avons renoncé ». À la fin de son livre, lors de la dernière apparition de la bête, Tesson semble sur le point d’être capable de ne plus tout ramener à l’humain et de penser à partir du point de vue de la nature : « La panthère ce matin n’était pas un mythe, ni un espoir, ni l’objet d’un pari pascalien. Elle se tenait là. Sa réalité était sa suprématie ».
Cela lui inspira l’un des plus beaux passages de son livre. Les yacks, dit-il, «étaient des totems envoyés dans les âges. Ils étaient lourds, puissants, silencieux, immobiles : si peu modernes! Ils n’avaient pas évolué, ils ne s’étaient pas croisés. Les mêmes instincts les guidaient depuis des millions d’années, les mêmes gènes encodaient leurs désirs. Ils se maintenaient contre le vent, contre la pente, contre le mélange, contre toute évolution. Ils demeuraient purs, car stables. C’étaient les vaisseaux du temps arrêté. La Préhistoire pleurait et chacune de ses larmes était un yack». Et Amiguet les filme comme ils devaient apparaître aux hommes d’avant le néolithique : lointains, imposants, sacrés, mystiques. Cette scène est grandiose.
Un autre rapport aux détails du monde
Ce film, et l’œuvre de Munier tout entière, font plus pour la conversion au monde que n’importe quel documentaire choc, que n’importe quel pamphlet qui fustige tous les blaireaux. En montrant la beauté, Munier nous apprend surtout à connaitre, à respecter et à aimer le monde naturel. Et ce que nous connaissons, nous ne pouvons y être indifférents. Pour un rapport plus harmonieux au vivant, pour en raviver les braises et pour y trouver une place, il faut impérativement réapprendre le détail du monde, ses lois, ses limites. « J’avais appris, dit Tesson dans les derniers instants, que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. Elle aidait à aimer le monde ».
La nature est la somme des détails du monde. Et c’est dans les détails que la vie prend son sens. Nos ancêtres ont vécu la nature plutôt qu’ils ne l’ont vaincu. À notre tour de la revivre et de changer notre rapport au monde. À la fin de son livre, Tesson détaille son nouveau mantra : « Vénérer ce qui se tient devant nous. Ne rien attendre. Se souvenir beaucoup. Se garder d’espérances, fumées au-dessus des ruines. Jouir de ce qui s’offre. Chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi. Se contenter du monde. Lutter pour qu’il demeure (…) Les champions de l’espérance appellent ‘’résignation’’ notre consentement. Ils se trompent. C’est de l’amour ». Consentir au monde, avant qu’il ne consente plus à notre survie.
La panthère des neiges, de Vincent Munier et Marie Amiguet, en salle le 20 mai.
Du même auteur
| 2024/04/26 | Incarner le Québec qui s’américanise |
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
| 2024/01/26 | De quel Godin te souviens-tu? |
| 2023/12/15 | La colère d’Octobre |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/05/10 | Notre ami Jacques Lussier (1960-2024) est mort |
| 2024/05/10 | Northvolt : Ne pas se surprendre de la radicalisation |
| 2024/05/10 | Une entrevue avec M. Léopold Beaulieu |
| 2024/05/08 | 10101010101010101 |
| 2024/05/08 | Communauté internationale dites-vous? |