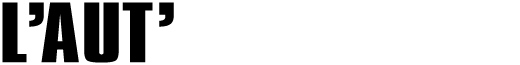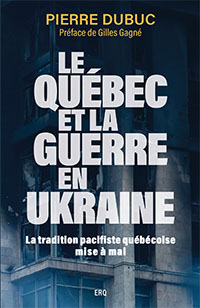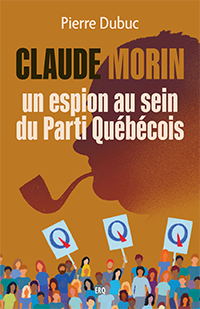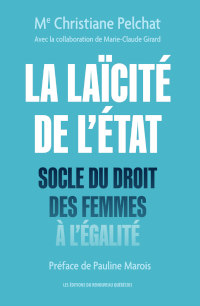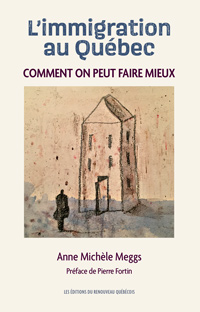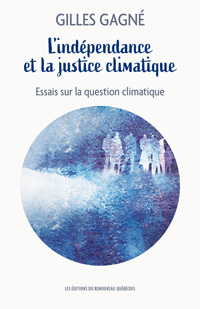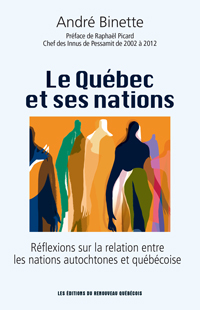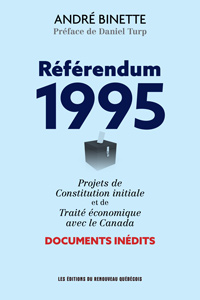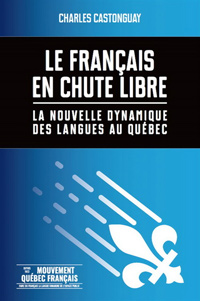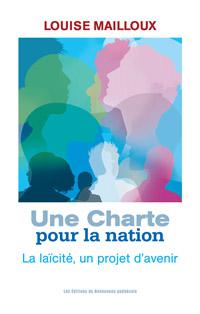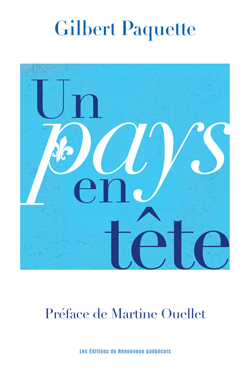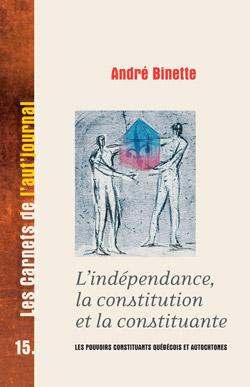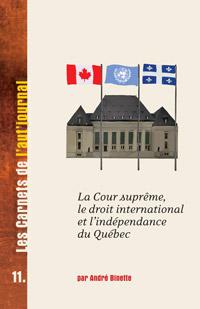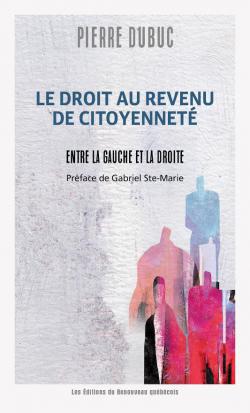Il y a une pénurie de main-d’œuvre dans le système public de santé au Québec, comme partout dans le monde. On entend le refrain tous les jours. Et il ne s’agit pas d’une pénurie ponctuelle. Aucune analyse ne laisse croire qu’elle va se résorber d’ici deux ou trois ans. Les raisons expliquant cette pénurie à long terme sont bien connues.
L’Organisation mondiale de la santé estime qu’il manquera 18 millions de travailleuses et de travailleurs de la santé d’ici à 2030. Les pays de tous les niveaux de développement socio-économique y font face, à des degrés divers.
Ce personnel est donc très précieux. Celles et ceux qui parlent français encore plus pour le Québec.
Ici comme dans la plupart des pays développés, le gouvernement semble être convaincu que l’immigration fait partie de la solution à ce problème. Il y a eu plusieurs reportages récemment dans les médias québécois sur des personnes immigrantes francophones travaillant dans le secteur public de la santé, parfois depuis deux ou trois ans, aux prises avec des problèmes de permis de travail temporaire, sur le bord d’être obligées de quitter le pays.
On blâme généralement le chaos administratif au fédéral. Mais, la véritable question serait plutôt : pourquoi le Québec a-t-il fait entrer ces personnes avec un statut temporaire ?
On tient pour acquis que, si le Québec recrute ces préposées et préposés, médecins et infirmières et infirmiers, c’est pour qu’ils et elles s’installent et demeurent ici.
Le Québec contrôle la sélection et les niveaux d’immigration sur son territoire. Il n’y a aucune raison pour que des personnes qui remplissent les conditions établies par le Québec ne puissent obtenir un Certificat de sélection du Québec qui leur accorderait la résidence permanente.
Le système informatique Arrima a été mis en place en 2018 spécifiquement pour accélérer le traitement des demandes d’immigration et pour permettre au ministère d’inviter des personnes ayant les compétences recherchées et ayant déclaré leur intérêt dans Arrima. Les chances d’être invitée sont encore plus grandes si la personne détient une offre d’emploi validée, surtout en région. Un établissement public de santé pourrait fournir une telle offre d’emploi. Le délai maximum pour traiter une demande complète est de six mois.
Il s’agit d’un processus bien plus simple que celui du Programme des travailleurs étrangers temporaires, qui exige des employeurs (mêmes publics) d’obtenir une Évaluation de l’impact sur le marché du travail (impliquant des frais et le temps de traitement de la demande par les deux ordres de gouvernement), et ensuite des personnes embauchées d’obtenir un Certificat d’acceptation du Québec, suivi d’un permis de travail temporaire du fédéral (d’autres frais et délais).
Le Québec peut faire mieux
Dès leur arrivée, ces perles rares convoitées par notre système public de santé pourraient jouir de la sécurité et de la stabilité qui viennent avec un statut permanent et avoir droit à tous les mêmes services que les membres de la société d’accueil. Le droit à la mobilité. L’assurance de pouvoir payer le loyer le mois prochain. Un accès à des prêts et à une hypothèque. Le droit de faire venir leur partenaire et les enfants, s’il y a lieu. Le droit de faire une demande de citoyenneté, de voter et de participer pleinement à leur nouvelle société.
Finie, l’angoisse des renouvellements du permis temporaire avec toute la paperasse et les frais que ça comprend. Finis, les frais de consultant ou d’avocat et la course auprès des députés et des journalistes pour savoir où est rendue leur demande.
On a même entendu des cas où des établissements du réseau public de la santé ont embauché, par la voie d’une agence à l’éthique douteuse, des préposés sans permis de travail, comme « bénévoles » payés en bas du salaire minimum !
Nous parlons ici du secteur public du Québec. Quel message le gouvernement envoie-t-il en traitant de façon si cavalière le personnel immigrant recruté pour soigner les malades et les personnes vulnérables de notre société ? Ces anecdotes font le tour du monde via les réseaux sociaux intéressés. Le Québec peut faire mieux.
Du même auteur
| 2024/05/31 | Immigration : Le Québec ni une province comme les autres, ni un État-nation |
| 2024/05/10 | Le Plan de la CAQ pour la langue française |
| 2024/04/17 | Immigration : Arrêtons la rhétorique ! |
| 2024/03/13 | Freiner les demandes d’asile |
| 2024/01/19 | Immigration temporaire : réformes fédérales en vue |