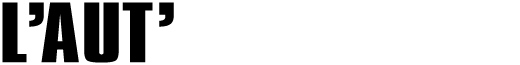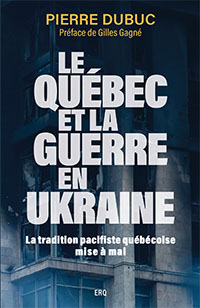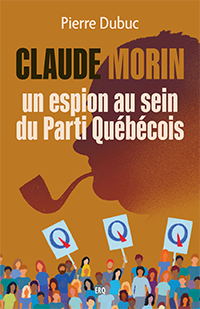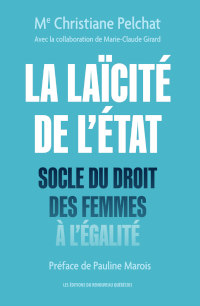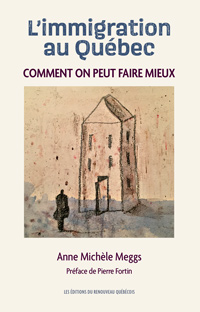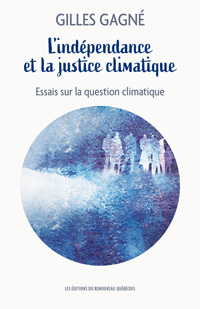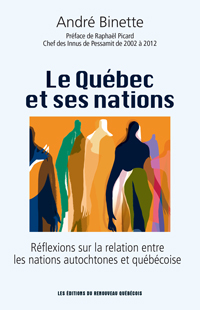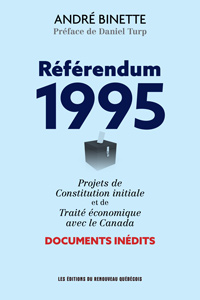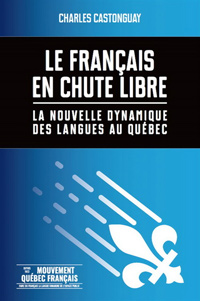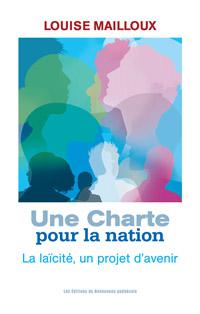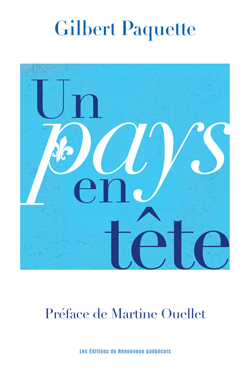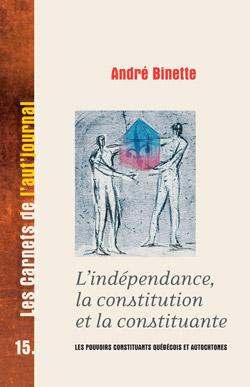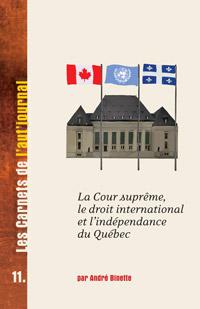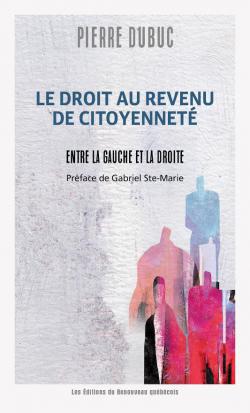Depuis quelques mois, je me sens dévitalisé à force de recenser des essais néoconservateurs comme Le retour des Bleus d’Étienne Beauregard et La nation qui n’allait pas de soi d’Alexis Tétreault. Quoique sincère, leur volonté de ramener la nation dans le débat public est malhabile et contreproductive. Malhabile parce revenir sans cesse au « Nous canadiens-français » est un leurre qui ne peut mener qu’au cul-de-sac : le Québec n’est pas homogène. Contreproductive parce que, habillée des oripeaux de l’intolérance, leur stratégie rebute une partie de la population du Québec, bien au-delà des seuls nouveaux arrivants et des minorités établies ici depuis longtemps.
Quel contraste de lire Le duel culturel des nations d’Emmanuel Lapierre! Un essai si généreux, qui va vers l’autre, qui veut convaincre plutôt qu’apeurer le lecteur, qui fait appel à son intelligence et à ses sentiments à la fois. Sans vraiment dire quelque chose de nouveau sur le nationalisme, Lapierre réussit à en parler d’une façon si intéressante et personnelle qu’il finit par faire voir la question d’un autre angle.
Une question universelle
Il est difficile de décrire cet essai qui relate le voyage intérieur de l’auteur, qui est aussi un voyage vers le passé et un voyage vers l’Autre, tous les Autres. Lapierre, dont le nom de famille ne laisse pas soupçonner qu’il n’est pas un « pure laine », comme on disait il n’y pas encore si longtemps, raconte comment il a vécu sa quête identitaire, lui dont le père est Péruvien et la mère est Québécoise. « Ni Québécois, ni Péruvien, ni Canadien, rien », résume-t-il.
Il montre bien que le nationalisme, loin d’être une fermeture sur soi, est en fait la façon universelle pour les peuples d’être au monde depuis le 18e siècle. Il rappelle que l’universel ne s’oppose pas au particulier et que, au contraire, la seule façon d’être universel est d’assumer parfaitement sa singularité. Cette singularité est l’endroit où se joue la condition humaine. C’est en accomplissant sa part de vérité unique que l’humain atteint l’universel. Tout simplement parce que la nationalité, d’ailleurs consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, est un marqueur identitaire qui répond à la question la plus fondamentale : qui suis-je? « Mieux se connaître en tant qu’être humain donne la possibilité d’agir dans l’intérêt de l’humanité », conclut-il.
À mille lieues de l’essai universitaire classique, Lapierre raconte en concomitance, dans une langue accessible et vivante, l’histoire du nationalisme et son histoire personnelle. Si l’on retrouve des mentions à certains théoriciens, le livre est d’abord un exemple de vulgarisation intelligente.
Une question progressiste
L’originalité de l’essai réside dans sa capacité à convaincre sans insister sur des arguments forts. C’est la forme qui assure l’argumentation, chose rare au Québec. Le pari de l’auteur, confie-t-il en entrevue, est de d’abord parler à ceux et celles à qui les essais sur la question nationale ne s’adressent généralement pas : « notre jeunesse, terminant son secondaire, au cégep, à l'université, jeunes adultes ».
Partant des philosophes des Lumières, Lapierre parcourt à grands traits les principales vagues du nationalisme depuis les trois derniers siècles en rappelant que le nationalisme est d’abord un « mouvement visant la liberté d’une nation donnée et l’égalité entre les humains vivant sur son territoire afin d’assurer l’existence de cette nation ». Il s’agit donc d’une notion foncièrement progressiste.
On passe notamment de la situation des Allemands de Bohème des 18e-19e siècle aux contradictions de Thomas Jefferson, l’anti-esclavagiste qui possède des esclaves et épouse une Noire; des réflexions d’Hannah Arendt sur le nazisme et celles d’Ernest Renan sur sa Bretagne natale qu’il voulait voir incorporée à la France, à la situation coloniale des Innus avec An Antan Kapesh; de l’américanisme des États-Unis vécu par Alfred Kazin au double du Canadien français ressenti par Jean Bouthillette. Ces exemples, tirés de différents contextes nationaux et différentes époques, montrent justement son point : la nation est à la fois universelle et singulière.
Une fausse opposition
À chaque occasion, Lapierre montre que la « dichotomie de Kohn » se rejoue faussement. Selon Hans Kohn, il y aurait deux sortes de nationalisme, l’un ethnique et l’autre civique, et le premier serait mauvais là où le second serait bon. Or, il n’en est rien : le nationalisme est à la fois invariablement ethnique et civique. Lorsque l’ethnicisme prend le dessus, c’est qu’il s’agit alors de racisme et de xénophobie.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Kohn a postulé que les nations anglo-saxonnes étaient les bonnes nations, celles dont le nationalisme était à suivre. Lorsque l'on connait l’histoire personnelle de Kohn, on comprend sa position intellectuelle sur la question. Juif autrichien aisé né en Bohème tchèque dans l’Autriche-Hongrie au tournant du 20e siècle, mais élevé dans la négation de sa judaïcité, Kohn sera déstabilisé par la chute de l’empire austo-hongrois à la fin de la Grande Guerre. L’établissement d’une nation autonome tchèque après la guerre le fera voir d’un très mauvais œil le nationalisme, lui qui profitait de son état de supériorité économique et culturelle en étant autrichien au sein d’un territoire tchèque annexé.
Lapierre montre bien que c’est la perte de son privilège d’appartenir à la minorité dominante de la région qui le rendra en fait réfractaire au nationalisme. Cela ne rappelle-t-il pas la situation des anglophones du Québec qui se plaignent du méchant nationalisme québécois depuis les années 1960? À l’instar de Kohn, mais dans une position inverse, l’auteur s’ouvre sur son identité personnelle afin de nous faire comprendre sa position intellectuelle. C’est que, en ces matières, l’objectivité complète est impossible.
Un duel culturel et politique
En lisant Johann G. Herder pour nous, Lapierre montre aussi comment l’idée d’une culture et d’une nation universelle est néfaste, qu’elle ne sert qu’à détruire les solidarités concrètes au profit de l’individualisme abstrait. Déjà Herder, au 18e siècle, dévoilait que cette idée ne pouvait être bénéfique qu’au capitalisme marchand et industriel. Trois siècles plus tard, son intuition est plus que confirmée.
Dans la deuxième section du livre, Lapierre explique que le « duel culturel des nations » est une constante de l’histoire humaine. Une nation dominante s’impose à une ou à des nations dominées. Il argumente que cette lutte est paradoxale puisqu’elle est « non pas dépourvue d’un caractère politique (…), mais soustraite à l’influence du politique », en ce sens qu’elle se joue au quotidien et qu’elle se fait passer pour autre chose qu’une lutte politique.
Mais, il s’agit d’un leurre puisque les institutions politiques reproduisent le duel entre les cultures en cachant qu’il est un enjeu de pouvoir. C’est pourquoi les « efforts des instances politiques pour le contrer restent inefficaces jusqu’à un certain point tant que le cadre du pouvoir n’est pas remis en question ». C’est ce que Maurice Séguin nommait « l’oppression essentielle » : il n’existe pas de culture pleine dans une situation politique dominée.
Cela explique d’ailleurs pourquoi Lapierre argumente que le caractère ethnique des nations est le meilleur rempart face à l’assimilation. Il a raison de rappeler que la singularité des nations doit être préservée, mais le discours ethniciste qui fait un retour en force met en danger l’universalité de l’être humain. L’essai tend parfois à minimiser le caractère néfaste du nationalisme fondé essentiellement sur l’ethnie. J’aurais d’ailleurs aimé qu’il aborde la complexité des relations à l’intérieur des nations plurielles depuis la deuxième moitié du 20e siècle.
Quoi qu’il en soit, Lapierre conclut, dans une formule digne de Séguin, qu’« exister n’est pas vivre ». « La liberté et la reconnaissance sont indispensables à l’existence », affirme-t-il dans un élan qui n’est pas sans rappeler Pierre Falardeau. Citant le « N’ayez pas peur » de Jacques Parizeau, il affirme que l’indépendance politique sera toujours la seule voie à suivre. Et il a tout à fait raison!
Du même auteur
| 2024/04/26 | Incarner le Québec qui s’américanise |
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
| 2024/01/26 | De quel Godin te souviens-tu? |
| 2023/12/15 | La colère d’Octobre |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/06/05 | Un lien essentiel entre politiques sociales et nationalisme |
| 2024/05/31 | La crise à QS, la résilience et l’internationalisme |
| 2024/05/29 | Rapatriement de la Constitution canadienne |
| 2024/05/29 | Le référendum n’est ni le seul ni le meilleur moyen |
| 2024/05/24 | Le pied à Papineau |