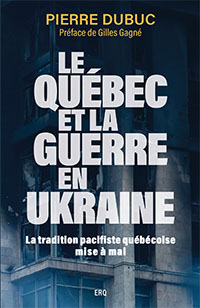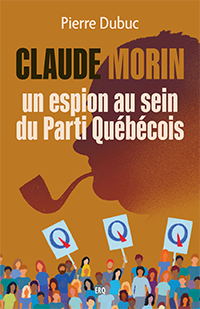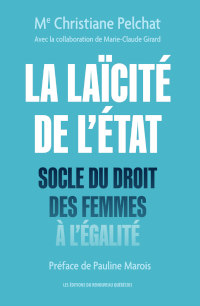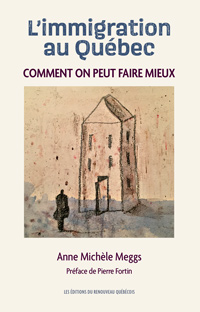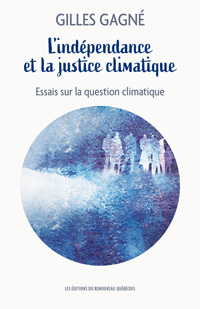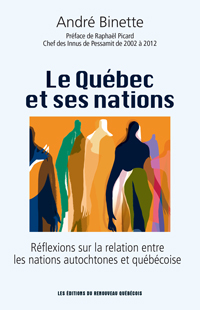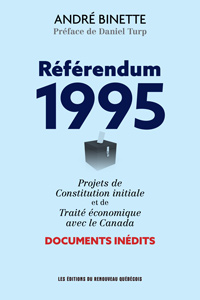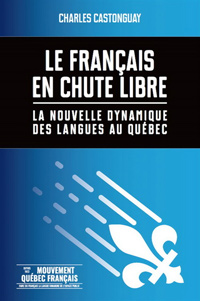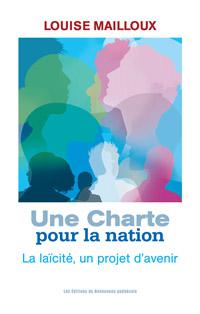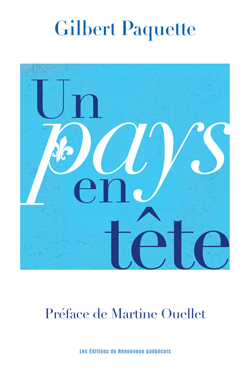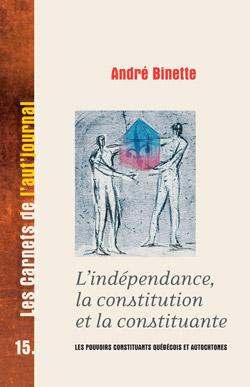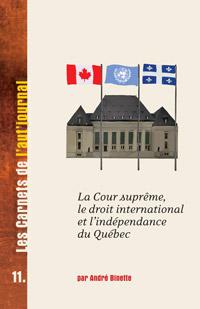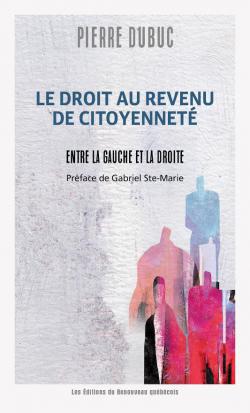Je navigue trop souvent sur les sites de vente de toutes sortes. De plus en plus de Québécois aux noms on ne peut plus canadiens-français décrivent l’article qu’ils souhaitent vendre directement en anglais. Parfois, sans même l’accompagner d’une version francophone. D’autres fois, avec une mention «je parle aussi français» à la fin de l’annonce. Très souvent, avec une traduction bilingue. «J’écris directement en bilingue», fait dire Pierre Falardeau à Elvis Gratton dans le deuxième volet de la trilogie.
Quarante-sept ans après la loi 101, nous voilà de retour au Québec où l’on affichait dans la «vraie langue», celle du maître, et qu’on traduisait en langue indigène pour ceux incapables de comprendre la «langue universelle». Cette régression s’accompagne inévitablement de l’arrogance de plusieurs anglophones et allophones qui se permettent d’écrire des annonces et de vous contacter directement en anglais. Pourquoi nous respecteraient-ils si nous nous agenouillons?
Nous sommes en train de nous dissoudre, tentation intermittente depuis 264 ans. Et tout cela se fait doucement, dans le confort virtuel. Heureusement, plusieurs sonnent l’alarme et des artistes osent dénoncer ce triste état de notre propre inaction.
Un Québec emprisonné
Se fondre, c’est le titre du dernier film de Simon Lavoie. Des prisonniers politiques québécois meurent à tour de rôle. On ne sait pas pourquoi. On ne voit que le dur système, la froide logique du système carcéral que l’on comprend être le système politique canadien. «L’univers carcéral, me confie le réalisateur, peut aussi se voir comme la métaphore, d’une certaine façon, d’une espèce d’enfermement du Québec.»
Le film ne se situe pas à une époque précise, même si la prison et la façon de tourner rappellent souvent Les ordres, de Michel Brault et si l’on est tenté de voir des références à la crise d’Octobre et au désœuvrement des prisonniers politiques qui ne savaient rien des chefs d’accusation portés contre eux ni de ce qui avait cours à l’extérieur des murs. Néanmoins, des appareils électroniques actuels nous rappellent que le Québec emprisonné est encore emprisonné. «Il y a quelque chose d’intemporel dans ce récit-là», affirme Lavoie pour qui le film se veut aussi une uchronie.
Une forme au service du fond
La forme du film, à la fois film d’auteur, pamphlet politique et de science-fiction, sort des sentiers battus. Un choix réfléchi et revendiqué par l’auteur qui m’explique qu’on ne peut pas, au Québec, avoir les mêmes ambitions stylistiques que dans le cinéma hollywoodien ou dans un film d’auteur à gros budget.
Poursuivant dans la veine de ses films Laurentie et Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que creuser leurs propres tombeaux, coréalisés avec Mathieu Denis, Lavoie sonde notre être collectif. S’intéresser à notre aventure collective, c’est un moteur puissant pour lui : «Le fait que l’on est une petite nation toujours menacée fait que l’on est dans une autre forme de proportion. Les artistes d’ici peuvent tutoyer cette nation.»
Il paraphrase ensuite Gilles Groulx qui affirmait que, si un artiste veut tenir un propos révolutionnaire dans un film, la forme doit aussi l’être. «Sinon, conclut le réalisateur, il y a quelque chose d’un petit peu caduc» dans la démarche. «Il fallait assumer une forme qui ose la transgression.» Malgré une forme non conventionnelle, l’intrigue se comprend facilement.
L’urgence d’agir
Le film, qui peut sembler sombre, n’est pas sans lumière, sans optimisme. Dès le début, le narrateur explique que les peuples n’ont pas d’essence et que c’est là que réside leur liberté. «Leur futur est imprévisible», résume la voix off.
Selon Lavoie, il y a néanmoins péril en la demeure : «Il y a une urgence d’agir parce que cette vision que propose le film n’est pas si loin de ça d’une réalité éventuelle qui risque d’être la nôtre, à savoir une marginalisation du français.»
Au-delà du système canadien qui est notre «oppression nécessaire», pour reprendre les termes de Maurice Séguin, dont des extraits de son œuvre sont lus durant le film, il y a une volonté de dénoncer l’invasion de l’anglais. L’anglais n’est jamais entendu dans Se fondre. Le procédé choisi par le cinéaste est d’écrire en français les mots des bourreaux avec la mention «prononcés en anglais» au bas de phrases laconiques.
Ce «procédé vieillot» du cinéma muet «crée d’autres genres de ressentis qui marquent une pause obligatoire dans le film», me confie Lavoie. «Le paradoxe, poursuit-il, c’était de montrer (l’omniprésence de l’anglais) sans faire entendre encore plus d’anglais et contribuer malgré moi à en rajouter parce que de plus en plus de cinéastes québécois tournent en anglais.»
Un art politique
C’est que le réalisateur assume pleinement une posture politique et ne se gêne pas pour se désoler de cet amour immodéré de l’anglais chez trop d’artistes. En entrevue, il développe longuement sur le fait qu’il y a peu de cinéastes qui font des films politiques, tâche pourtant essentielle. « Il faut que quelques-uns appellent un chat un chat et qu’ils parlent de notre réalité, argumente-t-il […] Le statu quo, c’est déjà le fédéralisme […] Détourner le regard ou parler d’autres choses, c’est déjà politique. Je pense qu’il faut résister. »
Et Lavoie n’a pas peur de se dire nationaliste : «La nation est quelque chose d’éminemment positif. […] Il faut assumer qu’au Québec le nationalisme a été très positif. Ça n’a jamais été ce que ça a été en Europe. Depuis 30 ans, c’est comme si cette idée de nationalisme même est diabolisée. Il y a toute une génération qui a intériorisé que c’était toxique l’idée de penser que l’on pouvait revendiquer notre indépendance nationale. […] Il faut comme déprogrammer le Québec. […] Il va falloir éventuellement transgresser … pour pouvoir inverser ce qui semble être le cours irrémédiable de notre destin collectif.»
Transgresser. Ce mot revient souvent dans la bouche de celui qui cite à plusieurs reprises Groulx et Falardeau. Tout comme les mots «assumer», «dépasser», «revendiquer». Ça fait du bien. Avec une connaissance certaine de l’histoire du cinéma et du Québec, il cherche à se situer dans cette tradition, à s’insérer dans quelque chose qui le précède. De ces cinéastes, il conserve cette volonté de délier nos chaînes.
Libérer la parole
Selon Lavoie, les artistes indépendantistes « sont beaucoup plus nombreux qu’on pense ». Il faut, croit-il, simplement que certains osent le dire, osent remettre l’idée au centre de leurs travaux. Il fait une analogie avec le joueur des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy, qui a affirmé à la fin de la Coupe Grey : «Gardez-le votre anglais!» «Ça crée un choc parce que la parole se libère, croit-il.»
C’est le rôle que Lavoie se donne, « bien humblement » : «On de la difficulté à juste dire des vérités qui sont comme évidentes. C’est comme si la parole demande à être libérée, des tabous demandent à être fracassés. Il y a beaucoup de gens qui pensent ces choses-là ou qui le ressentent confusément sans pouvoir le verbaliser. […] Il y a une sagesse populaire qui va faire en sorte que les gens, à l’intérieur d’eux-mêmes, vont comprendre que c’est vrai.» Effectivement, le nationalisme est quelque chose de très intime, ce que des œuvres d’art permettent d’encourager. Espérons que Se fondre trouvera son public et stimulera l’émulation.
Du même auteur
| 2024/05/17 | Présenter le nationalisme autrement |
| 2024/04/26 | Incarner le Québec qui s’américanise |
| 2024/03/22 | Le retour du provincialisme défensif |
| 2024/03/01 | Normaliser l’anormalité politique du Québec |
| 2024/01/26 | De quel Godin te souviens-tu? |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/06/07 | Je ne savais pas que j’allais me retrouver au cœur d’une guerre |
| 2024/05/31 | Libérer sa parole malgré les hivers de force |
| 2024/05/15 | Rendre accessibles nos trésors du 7e art |
| 2024/05/15 | Quand je ne serai jamais grande |
| 2024/05/10 | Notre ami Jacques Lussier (1960-2024) est mort |

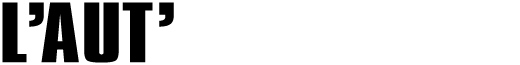
.png)