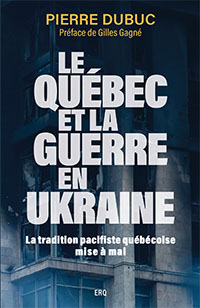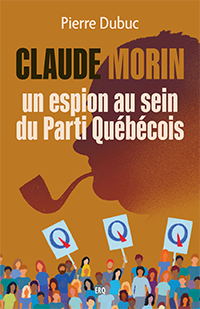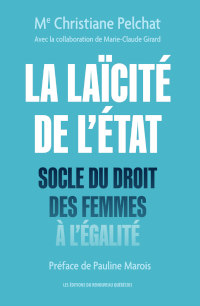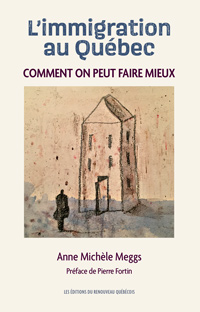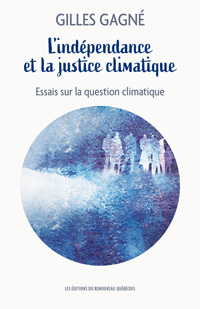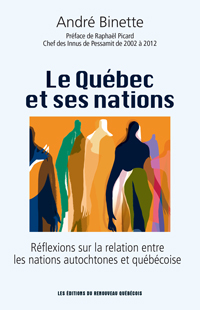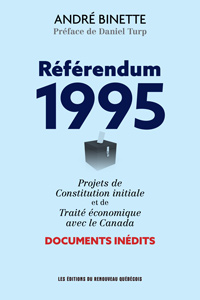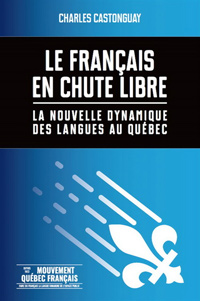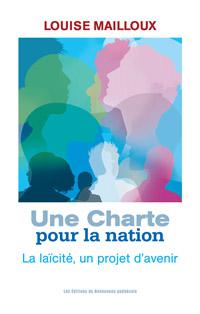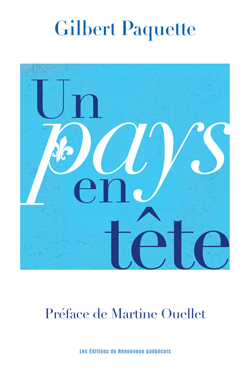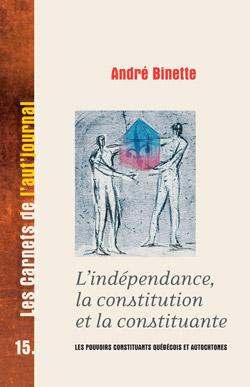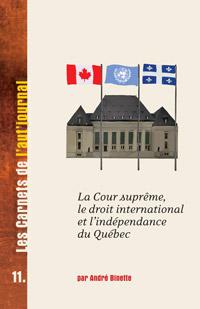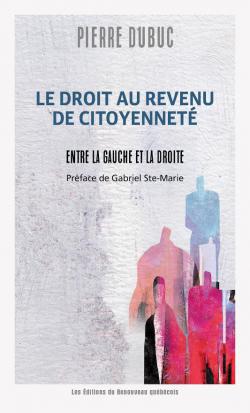Gabriel Nadeau-Dubois a lancé le débat sur le programme de Québec solidaire. L’exercice sera à l’ordre du jour pour tous les partis politiques en vue de la prochaine campagne électorale, mais il prend une signification particulière pour les partis qui veulent faire du Québec un pays.
Pour élaborer sérieusement un programme et une stratégie politiques, il faut préalablement déterminer les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons, la place du Canada et du Québec dans ce monde, de même que les intérêts des différentes classes sociales de notre société, les rapports entre elles, et préciser celles que le parti veut représenter.
L’arrière-plan historique
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise entre deux blocs – impérialiste et socialiste – en « guerre froide » l’un contre l’autre. Pour contrer l’attrait du socialisme, les pays avancés font des concessions aux classes ouvrière et populaire et aux nations opprimées. Au Canada, comme dans les autres pays avancés, c’est l’instauration des programmes sociaux et, au Québec, la Révolution tranquille. Ces trente années sont connues sous le vocable des «trente Glorieuses».
Lorsque Gorbatchev agite le drapeau blanc avec sa glasnost et sa perestroïka en 1986, le message est reçu dix sur dix par les dirigeants du monde capitaliste : l’URSS capitule. Finies les concessions au mouvement syndical. Déjà, Thatcher avait cassé la grève des mineurs, Reagan avait licencié les contrôleurs aériens, Mulroney s’en était pris aux chômeurs, Lévesque s'était colletaillé avec le Front commun. Le démantèlement de l’État-providence était à l’ordre du jour avec la dérèglementation, les privatisations et la libéralisation de l’économie (libre-échange).
Avec la chute du mur de Berlin et la dissolution de l’Union soviétique, le capitalisme triomphe avec arrogance. Il n’y a plus d’alternative, proclame Thatcher. Le livre de Francis Fukuyama, La fin de l’histoire, confirme, aux yeux des vainqueurs, la victoire absolue et définitive de la démocratie libérale.
Le marché socialiste est démantelé. Les pays de l’ancien bloc soviétique sont intégrés dans l’économie capitaliste. En Asie, la Chine est admise dans l’Organisation mondiale du commerce, les multinationales délocalisent leurs activités des pays avancés vers la Chine. Au Canada, la famille Desmarais de Power Corporation pilote des délégations commerciales en Chine. Les États-Unis s’imaginent à la tête d’un immense marché mondial sans frontières, redonnant vie à la théorie de l’ultra-impérialisme.
La loi du développement inégal
Mais, n’en déplaise à Fukuyama, l’histoire aura une suite. La bourgeoisie nationaliste russe, regroupée autour du KGB et de sa myriade d’entreprises, et représentée par Vladimir Poutine, réagira au dépeçage du pays par les multinationales étrangères et leurs alliés russes. Selon Catherine Belton, autrice du livre Les hommes de Poutine. Comment le KGB s’est emparé de la Russie avant de s’attaquer à l’Ouest (Talent Éditions, 2021), la Russie s’est détournée irrévocablement d’une intégration mondiale menée par l’Occident, lors de l’arrestation de l’homme le plus riche du pays, Mikhaïl Khodorskovski, alors qu’il était sur le point de vendre son entreprise YukosSibneft à Exxon Mobil pour 25 milliards $, sept ans seulement après l’avoir achetée pour 300 millions $.
En Chine Deng Xiaoping ouvre le marché chinois aux entreprises étrangères et encourage le développement, dans la plus grande discrétion, d’un capitalisme national. Les Chinois copient allègrement les procédés de fabrication des industriels occidentaux, si bien que leurs entreprises en viennent à les concurrencer avec succès.
Puis, la Chine se met à exporter à travers le monde une partie des gigantesques capitaux, accumulés dans le cadre de son industrialisation, pour mettre la main sur les ressources naturelles nécessaires pour assurer son développement. La politique, connue sous l’appellation « Route de la soie », a les caractéristiques classiques de l’impérialisme avec le financement d’exploitations minières, de routes, de voies ferrées et de ports pour extraire les richesses naturelles d’un pays et les acheminer en Chine.
Subitement, avec une économie plus performante, la Chine de Xi Jinping conteste la domination américaine. Le choc est brutal. L’Occident s’était endormi avec, entre les mains, La fin de l’histoire et se réveille avec Le Choc des civilisations, le livre de Samuel Huntingdon. Une fois de plus, la loi fondamentale du capitalisme – la loi du développement inégal des économies – a produit sa conséquence inévitable, la lutte pour le repartage du monde et des sphères d’influence entre les grandes puissances.
L’atout militaire
Désormais désavantagés économiquement face à la Chine, les États-Unis ont cependant une carte maîtresse dans leur jeu : leur puissance militaire. Reniant la promesse faite à Gorbatchev de ne pas « élargir d’un pouce » le territoire de l’OTAN, ils intègrent par vagues successives dans cette alliance militaire les pays de l’ex-bloc soviétique jusqu’aux portes de l’Ukraine, tout en sachant que son adhésion à l’OTAN est un casus belli, Napoléon et Hitler ayant envahi la Russie par les steppes ukrainiennes.
Au Moyen-Orient, le déclenchement des hostilités par le Hamas le 7 octobre avait pour objectif politique d’empêcher la conclusion d’un traité entre l’Arabie saoudite et Israël, sous l’égide des États-Unis, dans le but de contrer l’Iran. Selon le journaliste du New York Times Thomas Friedman, le projet d’entente est toujours sur la table et c’est pour ne pas le compromettre que Biden s’oppose à l’invasion de Rafah par Israël et se fait l’apôtre de la solution de deux États, condition sine qua non posée par Ryad. Selon Friedman, les Saoudiens s’engageraient dans le cadre de cette entente à freiner les investissements chinois dans leur pays.
Ainsi, les guerres en Ukraine et à Gaza débordent leur cadre national et doivent être analysées dans le contexte de l’affrontement entre grandes puissances, comme je l’ai démontré, dans le cas de l’Ukraine, dans mon livre Le Québec et la guerre en Ukraine.
L’islam comme alternative?
La dissolution de l’URSS a jeté le discrédit sur le socialisme comme référence dans le combat contre l’impérialisme. La Russie ne se prétend pas socialiste et la Chine parle d’un socialisme aux caractéristiques chinoises, bien loin de l’ancien internationalisme socialiste.
Dans plusieurs régions du monde, les idéaux socialistes ont été remplacés par l’islamisme, ce qui représente une énorme régression idéologique. L’identification religieuse remplace la nationalité, la charia le programme démocratique et l’Oumma – la communauté des fidèles – les nations. L’offensive islamiste n’exclut pas les pays avancés, où la confrérie des Frères musulmans cherche à élargir le champ d’influence de l’islam.
Le Canada et le Québec
Dans ce nouvel environnement mondial, le Canada est sommé de limiter ses relations avec la Chine et de s’aligner sur les États-Unis : bannissement de Huawei, veto américain sur tout projet de libre-échange avec Beijing lors du renouvellement de l’ALENA, augmentation du budget militaire.
Au plan économique, le Canada est aussi contraint de s’inscrire dans le plan Biden de « transition écologique », un terme trompeur pour camoufler les préparatifs de guerre : mégasubventions à la filière batterie, intensification de l’exploitation minière, intégration énergétique.
Le Québec n’y échappe pas avec, entre autres, le projet à l’étude d’une grande boucle reliant les centrales de Churchill Falls, Muskrat Falls et, éventuellement, Gull Island au réseau de la Nouvelle-Angleterre en passant par les provinces maritimes avec un retour vers le Québec pour profiter des réservoirs d’Hydro-Québec comme « batteries » pour stocker les surplus de production éoliens et solaires des États-Unis. Le Québec perdrait alors le contrôle sur Hydro-Québec.
Des enjeux à débattre
Un parti politique, qui veut faire du Québec un pays comme le PQ et QS, doit impérativement se prononcer sur ces questions : la politique étrangère (alignement sur la politique belliciste des États-Unis et du Canada ou renouer avec la tradition pacifiste du Québec); la laïcité, l’islam et la question des femmes; l’intégration énergétique nord-américaine.
(à suivre)
Du même auteur
| 2024/06/29 | Marc tenait le micro… |
| 2024/06/20 | Bientôt la conscription? |
| 2024/06/07 | Faire payer Facebook : un fiasco |
| 2024/06/05 | Ukraine-Russie : Quand la paix était à portée de main |
| 2024/05/03 | Mathieu Bock-Côté et l’impôt |
Pages
Dans la même catégorie
| 2024/06/29 | Marc tenait le micro… |
| 2024/06/20 | Micheline Labelle, de tête et de rigueur, de cœur et d’engagement |
| 2024/06/20 | Avant que le Québec ne fonde |
| 2024/06/20 | Une entrevue avec M. Gérald Larose |
| 2024/06/05 | Sexe, genre et Jeux olympiques |

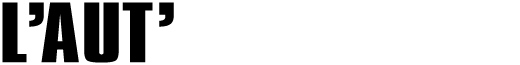
.png)